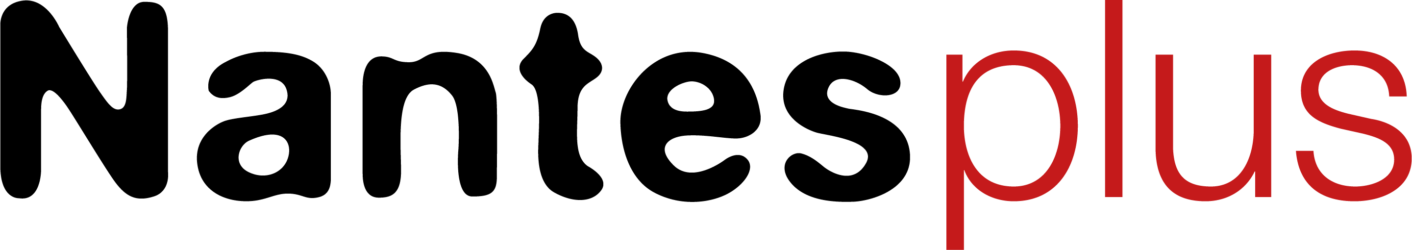« L’art de la politique et le goût de la nuance ne font pas bon ménage » note Bruno Geoffroy, citant en exemple Marine Le Pen dans un éditorial de Presse Océan (19 avril). Il aurait pu encore mieux citer Johanna Rolland, qui vient de publier dans Le Monde une tribune intitulée « Au regard de sa responsabilité historique, la France ne peut pas détourner son regard d’Haïti ».
Le texte, co-signé avec ses collègues Pierre Hurmic et Jean-François Fountaine, commence ainsi : « Nous, maires de Bordeaux, Nantes et La Rochelle, avons choisi d’assumer une responsabilité particulière et d’engager un travail de mémoire quant à la dette haïtienne. »
Un « travail de mémoire » paraît en effet indispensable ! Car la tribune explique ensuite ceci :
Il y a exactement deux siècles, le 17 avril 1825, la France concédait l’indépendance « pleine et entière » à son ancienne colonie de Saint-Domingue, qui avait gagné son indépendance face aux troupes napoléoniennes et pris le nom d’Haïti vingt et un ans plus tôt, moyennant le versement d’une somme de 150 millions de francs or. Forcé d’accepter cette demande sous la menace militaire et dans le but d’avoir une reconnaissance internationale comme État indépendant, Haïti se voyait aussitôt contraint d’emprunter auprès de banques françaises pour assurer le premier versement, subissant ainsi le poids d’une double dette : celle de l’emprunt et celle des intérêts de l’emprunt.
C’est beaucoup d’erreurs en deux phrases – peut-être pas toutes involontaires.
Sur les dates, d’abord, ce qui n’est pas nouveau. Saint-Domingue n’a pas « gagné son indépendance face aux troupes napoléoniennes ». La colonie était indépendante de facto depuis la révolution de 1791 ; l’expédition Leclerc de 1801 n’a rien pu y faire. La déclaration d’indépendance formelle du 1er janvier 1804 était un acte de majesté de la part de Jean-Jacques Dessalines (1758-1806), qui en était friand : il serait bientôt couronné empereur. Quant à la date de l’indépendance « pleine et entière », l’ordonnance signée par Charles X le 17 avril 1825 n’est entrée en vigueur qu’une fois « entérinée » par le sénat d’Haïti, le 11 juillet 1825. Si l’on tient à commémorer le bicentenaire d’une dette éteinte depuis longtemps – drôle d’idée quand même ‑, autant le faire à cette date, le 11 juillet, respectant la souveraineté haïtienne.
Car Haïti a veillé à formaliser son accord de manière souveraine et solennelle. Comme le note Johanna Rolland – qui a raison sur ce point –, Haïti tenait à « avoir une reconnaissance internationale comme État indépendant ». D’abord pour des raisons de prestige, même si son président, Jean-Pierre Boyer (1776-1850), était moins ardent que Dessalines sur ce point. La Grande-Bretagne venait de reconnaître la plupart des nouveaux pays d’Amérique latine, Haïti en demandait autant. Mais aurait préféré que Charles X « reconnaisse » son indépendance au lieu de la lui « concéder ». Qu’importe : après discussion, les dirigeants haïtiens ont considéré que l’indépendance était « ratifiée », et chacun s’est diplomatiquement satisfait de l’ambiguïté.
Une indemnité proposée par Haïti
Les conditions financières de l’accord ont posé moins de problèmes que le vocabulaire. La première, omise par Johanna Rolland et ses collègues, était l’ouverture des ports « au commerce de toutes les nations ». Cette contrepartie de l’indépendance nationale levait un sérieux obstacle au développement économique du pays. Au passage, la France obtenait de payer moitié moins de droits que les autres pays sur les marchandises entrantes ou sortantes. Il a été calculé que cela représentait pour elle un avantage de 1,5 millions de francs par an – mais pour Haïti, 50 % de quelque chose était grandement préférable à 100 % de rien du tout.
Les 150 millions de francs destinés à l’indemnisation des colons spoliés ne venaient qu’ensuite, dans l’article 2 de l’ordonnance de Charles X. La tribune du Monde y voit peu ou prou une forme de racket royal. Or le principe d’une indemnité avait été proposé dès 1814 par Alexandre Pétion (1770-1818), alors président de la République d’Haïti. En 1821, Dupetit-Thouars, envoyé du président Jean-Pierre Boyer, avait réitéré à Paris l’offre haïtienne d’« une indemnité raisonnablement calculée ». En 1824, les plénipotentiaires Larose et Rouanez étaient autorisés par Boyer à convenir « qu’en témoignage de la satisfaction du Peuple Haïtien pour l’acte de philanthropie et de bienveillance émané de S. M. T. C. [Sa Majesté très chrétienne], il sera accordé par le gouvernement d’Haïti au gouvernement français, en forme d’indemnité, une somme de… » Ils avaient proposé 80 millions de francs ; après discussion, la somme avait été portée à 100 millions. Le baron de Mackau, représentant de Charles X venu présenter l’ordonnance royale à Jean-Pierre Boyer, assura que le roi accepterait d’en rabattre sur les 150 millions dans le cadre d’un traité ultérieur. On voulut bien le croire…
Johanna Rolland et ses cosignataires assurent qu’Haïti a été « forcé d’accepter cette demande sous la menace militaire ». C’est une erreur – très répandue il est vrai ! Haïti tenait à l’ordonnance et aucune action militaire n’était envisagée par la France, qui n’en avait d’ailleurs pas les moyens. La fausse nouvelle est venue de ce que Mackau disposait d’une douzaine de navires ‑ question de prestige mais aussi de sécurité : les mers n’étaient pas sûres et la France sortait d’une guerre avec l’Espagne. L’expédition Leclerc de 1801 comptait trois fois plus de bâtiments et avait été un désastre.
Un endettement mal calculé, ça arrive
Toutes ces péripéties sont parfaitement connues et détaillées par les deux grands historiens haïtiens, Beaubrun Ardouin (1796-1865) et Thomas Madiou (1814-1884). Comment la maire de Nantes pourrait-elle ignorer les écrits de ce dernier, un ami de notre Ange Guépin ?
Revenons à la dette haïtienne. Ses 150 millions de francs équivalaient à quelque chose comme 20 % du PIB de Saint-Domingue avant la révolution. Hélas, après la révolution, suivie d’une guerre civile, le PIB s’était effondré. En 1825, les 150 millions pouvaient représenter au moins une année de PIB (comme si la France était grevée de 3 000 milliards d’euros de dette, imaginez un peu !). Mais Jean-Pierre Boyer était un homme optimiste et peut-être un tantinet fanfaron. Il lui fallait une reconnaissance internationale, quoi qu’il en coûte. D’ailleurs, l’économie haïtienne était de nouveau en plein essor grâce à la culture florissante du café. Et puis, Haïti venait d’annexer la partie espagnole de l’île d’Hispaniola : la dette serait assumée par un pays 2,7 fois plus vaste. Personne ne savait alors que l’envolée de la production brésilienne allait laminer les cours du café, ni que Haïti devrait abandonner ses conquêtes territoriales en 1844.
Les trois maires français semblent ignorer qu’après un premier versement de 30 millions et une longue période de défaillance, le solde dû a été ramené à 60 millions de francs en 1838. Total, donc, 90 millions « seulement »… soit 10 % de moins que les 100 millions d’indemnité convenus entre Français et Haïtiens en 1824 ! Bien entendu, la dépréciation de la monnaie avait fait son œuvre : si 150 millions de francs de 1825 équivalaient à 450 millions d’euros d’aujourd’hui, 60 millions de francs de 1838 ne représentaient plus que 150 millions d’euros. Le règlement de cette somme s’est étalé sur des décennies, au cours desquelles sa valeur réelle a encore rétréci.
Johanna, Emmanuel, même dette mémorielle
In fine, sur plus d’un siècle, Haïti aurait versé « l’équivalent de 525 millions d’euros à la France » affirme Johanna Rolland en se référant à des calculs du New York Times. Depuis le début du 21e siècle, les sommes apportée par la France à Haïti ‑ aides publiques, dons des ONG et annulations de dette ‑ se montent à environ 600 millions d’euros. Johanna Rolland compte-t-elle réclamer un trop-perçu ?
Les 90 millions de francs de la dette haïtienne réelle équivalaient en 1825 à environ 270 millions d’euros d’aujourd’hui, soit environ 300 euros par citoyen. Comparaison n’est pas raison, mais au 31 décembre 2023, l’encours total de la dette de Nantes Métropole dépassait 1 061 millions d’euros, soit 1 550 euros par habitant. Comparaison n’est pas raison (bis) mais Haïti espérait payer avec ses ventes de café ; Nantes Métropole compte plutôt sur les impôts payés par ses contribuables. Le café n’a pas tenu ses promesses.
La tribune publiée par Johanna Rolland et ses collègues marque-t-elle un rapprochement avec Emmanuel Macron ? « En ce bicentenaire, il nous faut, ici comme ailleurs, regarder cette Histoire en face. Avec lucidité, courage et vérité », a déclaré le président de la République jeudi. Il a annoncé la création d’une « commission mixte franco-haïtienne chargée d’examiner notre passé commun et d’en éclairer toutes les dimensions ». Johanna Rolland va pouvoir actualiser ses connaissances. Ce qui risque de réclamer en effet lucidité, courage et vérité.
Sven Jelure
Partager la publication "La mémoire haïtienne de Johanna Rolland a des lacunes"