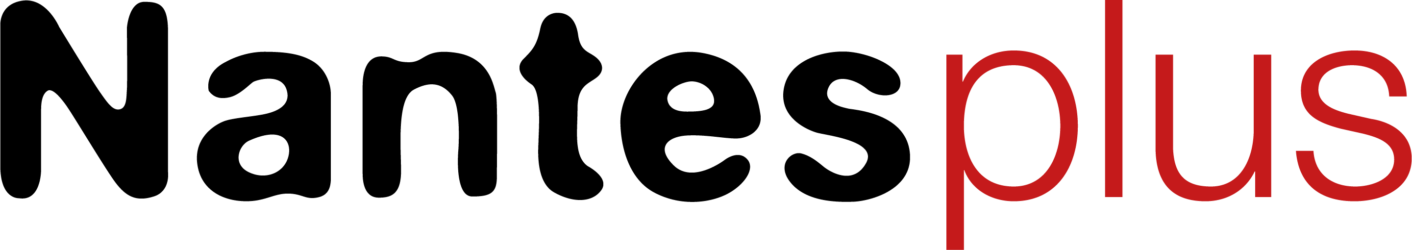L’exposition sur l’hyperréalisme visible au musée d’arts de Nantes jusqu’au 3 septembre révèle en creux les faux-semblants et les obscurités d’un courant artistique largement fabriqué, plus conceptuel que réel. L’occasion de découvrir enfin cette vérité cachée depuis l’Origine du monde : l’art peut viser à représenter le réel et, ce faisant, susciter les mêmes émotions que lui.
« C’est très ressemblant », jauge madame.
« Ressemblant à quoi ? » répond mademoiselle, 12 ans à tout casser.
Reste d’objectivité enfantine, début de rébellion adolescente ? En tout cas, la demoiselle met le doigt sur un aspect fâcheux de l’exposition Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste, visible au musée d’arts de Nantes jusqu’au 3 septembre : elle ressemble beaucoup au même genre de regard posé sur le même genre de sculpture voici seulement quelques mois, du 8 septembre 2022 au 5 mars 2023, au musée Maillol de Paris sous le titre Hyperréalisme – ceci n’est pas un corps. La même exposition avait précédemment fait halte à Lyon et dans plusieurs villes d’Europe.
Le musée d’arts pousse la ressemblance jusqu’à évoquer dès l’entrée « la sculpture hyperréaliste, née aux États-Unis dans les années 1960 » alors que le musée Maillol affirmait : « L’hyperréalisme est un courant artistique apparu dans les années 1960 aux États-Unis ». Raccourci plus que discutable. À l’époque, les sculpteurs américains aujourd’hui rangés parmi les hyperréalistes sont en fait qualifiés de « photoréalistes » : leur travail vise à la précision de la photo. Parfois, il reproduit littéralement les détails fixés sur la pellicule. Certains critiques américains parlent, en français dans le texte, de « trompe-l’œil ».
Si une école se cherchait alors face à l’art abstrait, à l’expressionisme social ou au réalisme socialiste, c’était le « Nouveau réalisme ». Un Manifeste du nouveau réalisme avait même été publié en 1960 avec l’aval de célébrités comme Arman, Klein ou Tinguely. Des expositions explicitement labellisées « Nouveau réalisme » étaient organisées en France et aux États-Unis.
Une affaire de marchands
Et si l’on tient à désigner un acte fondateur de l’hyperréalisme, il ne se situe ni aux États-Unis ni dans les années 1960 : c’est une exposition organisée à Bruxelles en 1973 par le galeriste Isy Brachot. L’hyperréalisme est finalement un label de marchands. « Lorsqu’une nouvelle école apparaît, les critiques d’art qui apprennent les choses sur le tard sont heureux : ils pensent avoir repéré, déniché et catalogué une tendance de l’Art Moderne », ricanait à l’époque l’anthropologue Bernard Mérigot. « Au pire, ils décrètent qu’il s’agit d’une mode. Sur ce « mode », on démontre sans s’interroger plus avant, que la raison de ce subit intérêt, c’est ‑ comme on dit ‑ que c’est dans l’air. Donc, l’hyperréalisme est dans l’air(1). »
Il y a été, il n’y était plus, il y revient. Chercherait-on à réinventer aujourd’hui une tendance artistique, voire à sortir de vieilles gloires du classique purgatoire commercial post-mortem ? « L’évènement tente de constituer une école d’artistes », soupçonne Yaël Hirsch à propos de l’exposition Hyperréalisme de Paris. « Particulièrement au Musée Maillol, l’exposition hyperréalisme parvient à nous convaincre qu’il existe un courant artistique méconnu et qu’il est important », poursuit la directrice de Toute la culture, qu’on sent pourtant modérément convaincue(2). « Reste à parier que l’évènement fera date et école… », ajoutait-elle. Bien vu ! Nantes n’a pas tardé à saisir la main tendue.
Tout en reconnaissant le charme de plusieurs œuvres (« on se laisse saisir comme par des humains » ‑ eh oui, l’objet veut procurer la même émotion que le réel) Yaël Hirsch note des « clins d’œil » vers l’abstrait, le surréalisme et même le difforme. Que n’aurait-elle pas dit en visitant le patio du musée nantais ! La trentaine d’œuvres qu’il héberge forme un assemblage très disparate. Il n’y a rien de commun, rien du tout, entre l’Amber de John de Andrea, jolie blonde en tenue d’Ève, et l’installation Excentrique de Daniel Firman.
Cette dernière représente une pyramide humaine (dont les neuf personnages auraient paraît-il été moulés sur le corps de l’artiste), mais de ces « humains » on ne voit rien d’autre que les formes dissimulées sous des anoraks, des pantalons, des bonnets : « les visages par lesquels advient la rencontre sont ici dissimulés – pour mieux attester de l’énergie du collectif », assure un critique miséricordieux. Elle ressemble « à un gros gag réalisé avec des mannequins des Galeries Lafayette réformés », corrige un autre, dont on taira le nom.
Duane Hanson en majesté
Entre les deux, la Flea Market Lady de Duane Hanson (1925-1996). Le travail matériel de l’artiste a consisté à confectionner avec de la résine un visage, deux avant-bras et deux jambes, soit une partie minoritaire de l’œuvre ; pour le reste, le corps de la grosse dame est couvert de vêtements et environné d’objets provenant sans doute d’un vide-grenier authentique ‑ non pas hyperréel mais réel tout court. Inévitablement, l’installation fait penser aux personnages de cire mis en scène par Madame Tussauds et le musée Grévin. Simplement, la vedette est ici une mémère en surpoids et pas la reine d’Angleterre.
Est-elle moins touchante pour autant ? Pas forcément. « Il est toujours fascinant de regarder le public au contact des œuvres de Hanson, d’assister à cet inévitable moment « waouh » », note l’écrivain Douglas Coupland(3). « Elles semblent faites sur mesure pour notre époque. En fait, pourrait-il exister une œuvre qui soit plus propice aux selfies [« selfie-friendly »] que celle de Hanson ? ». Si cette matrone affalée sur son fauteuil pliant est une œuvre d’art, pourquoi pas mon auto-portrait au smartphone ?
Or la « dame du marché aux puces » joue un rôle essentiel ici. C’est l’œuvre par laquelle le musée d’arts légitime son initiative : il est la « seule collection publique française à conserver une sculpture de l’artiste américain Duane Hanson », classiquement cité comme l’un des maîtres de l’hyperréalisme. Cette sculpture de 1990, acquise par le musée en 2011(4), est même l’œuvre la plus célèbre de Duane Hanson. Il en a fabriqué et vendu quatre exemplaires, différenciés par l’accoutrement de la dame et le bric-à-brac qu’elle propose aux chalands. (L’exemplaire de Nantes est probablement le numéro deux, mais le compte n’est pas garanti.) Chaque passage de l’un d’eux en vente publique, chaque exposition dans une galerie, accroît la notoriété collective des quatre. Celui à la visière jaune, censé être la tête de série, aurait été adjugé 275 000 dollars chez Phillips en 2019.
Les contours flous de l’hyperréalisme
À fouiller dans ses réserves, le musée aurait pu retrouver aussi une œuvre de Daniel Spoerri, l’Hommage au jardin d’hiver de la baronne Salomon de Rothschild, qu’il a exposée en 2019 à l’occasion de l’exposition Saveurs d’artistes, dans la cuisine des peintres. Ces reliefs de repas collés sur des tables de bridge auraient été assez raccord avec le thème du patio 2023. D’ailleurs, comme Duane Hanson, et même plus que ce dernier, Spoerri a parsemé son œuvre d’objets glanés sur les marchés aux puces. Hélas, il était aussi l’un des hérauts autoproclamés du « Nouveau réalisme » cité plus haut. Le frotter aux hyperréalistes aurait souligné le flou de l’appellation.
Circonstance aggravante : l’une de ses œuvres les plus connues est basée sur un reste de repas de Marcel Duchamp, et évoquer une éventuelle filiation entre le ready-made ou l’art conceptuel et l’hyperréalisme aurait été de mauvais goût. Pourtant, quand on expose à Nantes le bout d’une chaussure dépassant d’un tas de serviettes, œuvre de Saana Murti, n’est-ce pas du ready-made ? Eh bien, non, c’est quand même de l’hyperréalisme… car le tout est parfaitement imité en céramique !
Les onze artistes exposés à Nantes, Gilles Barbier, Berlinde De Bruyckere, John DeAndrea, Daniel Firman, Duane Hanson, Sam Jinks, Tony Matelli, Saana Murtti, Evan Penny, Marc Sijan, Tip Toland, ne sont pas tous hyperréalistes, contrairement à ce que dit Emmanuelle Jardonnet dans Le Monde. Sophie Lévy, directrice du musée d’arts, et Katell Jaffrès, commissaire de l’exposition, en conviennent : leur exposition « réunit des artistes dont l’œuvre est exclusivement hyperréaliste et d’autres qui en font usage de manière ponctuelle ou partielle ». Il est prudent de le dire. Les Nantais pourraient se souvenir des œuvres lumineuses de Daniel Firman exposées au théâtre Graslin et au sous-sol du Carré Feydeau pour le Voyage à Nantes 2018, que nul n’aurait considérées comme « hyperréalistes ».
Inversement beaucoup de ceux qui ont été qualifiés d’hyperréalistes à un moment ou un autre, dans les années 1970 ou depuis lors (Robert Bechtle, Maurizio Cattelan, Eric Christensen, Chuck Close, Robert Cottingham, Dirk Dzimirsky, Don Eddy, Richard Estes, Carole Feuerman, Frantz Gertsch, John-Mark Gleadow, Ralph Goings, Jean Olivier Hucleux, Allen Jones, Howard Kanovitz, Richard McLean, Ron Mueck, Patricia Piccinini, Gérard Schlosser, Bruno Schmeltz, George Segal, Alexander Volkov, Erwin Wurm, Sun Yuan, etc.), n’y sont pas. D’abord, l’exposition est limitée aux sculpteurs, et surtout le regard ne peut voir partout.
Œuvres hyperréalistes, visiteurs hyperconceptuels
En tout état de cause, l’art n’a pas attendu les années 1960 pour tenter des représentations minutieuses de la réalité. Très hyperréalistes, dans le fond, sont les animaux de Lascaux exploitant les formes naturelles de la roche, les huit mille soldats en terre cuite peinte enterrés avec l’empereur Qin Shi Huang voici vingt-deux siècles, les statues polychromes de l’Antiquité gréco-romaine ou les épouvantails agricoles d’autrefois munis d’un balai et coiffés d’un chapeau. Et plus encore, évidemment, l’immense phalange des œuvres religieuses, en particulier des Christ en croix : des générations d’artistes ont cherché à représenter avec un maximum de vérité la souffrance du supplicié, y compris parfois avec des ronces cueillies dans la haie et les clous du maréchal-ferrant.
Ce qui change au fil des siècles, ce sont surtout les techniques disponibles Le but, lui, est toujours le même : susciter la même émotion que la réalité. Pygmalion tombe amoureux de sa statue, le chrétien tombe à genoux devant la crucifixion – et les oiseaux s’enfuient à tire-d’aile devant l’épouvantail.
Aussi le musée d’arts ne se prive-t-il pas d’apposer à côté de ces œuvres très matérielles des cartels qui invitent aux débordements sentimentaux et imaginatifs. « Il ne reste plus que l’absence d’un corps qui a laissé derrière lui ces objets abandonnés, écrit-il à propos de la chaussure sous les serviettes de Saana Murti, mille histoires restent à inventer, à partir des vestiges d’une présence volatilisée » : de l’art de se faire des nœuds au cerveau sans nécessité. « Quand l’exposition montrée à Maillol détaillait les grandes typologies du genre (…), l’exposition nantaise se fait plus philosophique, comme pour faire écho à l’hypersensibilité exprimée par les œuvres », remarque Emmanuelle Jardonnet, peut-être légèrement ironique.
À voir quand même
Une exposition à fuir, donc ? Mais non, pas du tout ! Pour un musée des beaux-arts de province, qui plus est privé désormais de « beaux », faire du chiffre n’est pas facile. Un peu de racolage, un peu de poudre aux yeux, un peu de nudité aident à attirer le bon peuple, quitte à endurer quelques sarcasmes (voir ci-dessus). Sophie Lévy l’avait déjà fait habilement en 2018 avec Le Scandale impressionniste, peu impressionniste et encore moins scandaleux, mais vendeur. Cette fois, sa communication met en avant la charmante Amber – presque de la publicité mensongère, mais efficace.
Soyons honnête : il y a tout de même plein de choses à voir en plus d’Amber. Par exemple, les mauvaises herbes de Tony Martelli, parfaitement imitées, qui jaillissent des plinthes du patio comme partout sur les trottoirs nantais : en voilà de l’art inspiré de la réalité !
Il y a aussi le public. Étonnantes, cocasses ou instructives, on espère que ses réactions sont discrètement observées par les chercheurs d’un labo de sciences cognitives, ou alors c’est vraiment du gâchis. On pourra aussi s’amuser à rechercher parmi le gros contingent de gardiens plantés autour de l’exposition ceux qui sont en fait des statues hyperréalistes.

Enfin, en sortant du musée l’esprit ouvert à cette école qui n’en est pas vraiment une, si vous voulez vraiment voir une expo hyperréaliste avec un vrai moment « waouh » garanti, offrez-vous une visite de l’exposition Ron Mueck à la Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail à Paris, jusqu’au 5 novembre.
Sven Jelure
___________
(1) Bernard Mérigot, « De l’hyperréalisme, de l’objet et du réel en psychanalyse », Les Cahiers de l’Art concret, décembre 1972.
(2) Elle n’est pas la seule, évidemment. Jean-Pierre Dalbéra est plus sévère : « D’autres artistes européens moins connus figurent dans l’exposition mais pourquoi les classer parmi les sculpteurs hyperréalistes alors que ces techniques sont aujourd’hui plus largement diffusées et accessibles que dans les années 1960 ? C’est à la catégorie de l’art conceptuel que l’on fait référence plutôt qu’à l’hyperréalisme. Cette forme a indéniablement marqué une étape dans l’histoire de l’art après le pop art, elle n’est plus guère pertinente à l’heure de l’art numérique et de l’intelligence artificielle. »
(3) Douglas Coupland, « Duane Hanson: ‘An artist tailor-made for the age of the selfie’ », The Guardian, 26 mai 2015. Selon Coupland, la technique de Duane Hanson n’est pas un hyperrealism mais une realness, « terme utilisé par les drag queens dans les concours d’archétypes : femme blanche riche habillée pour le déjeuner, lycéens footballers se préparant à la photo de classe annuelle » ‑ l’archétype, universel, ne devant pas être confondu avec le stéréotype, exagération temporaire.
(4) On trouvera la composition exacte de l’œuvre, articles de vide-grenier compris, sur https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/artwork/110000000070670
Partager la publication "Hyper sensible au musée d’arts de Nantes : ceci n’est pas une exposition"