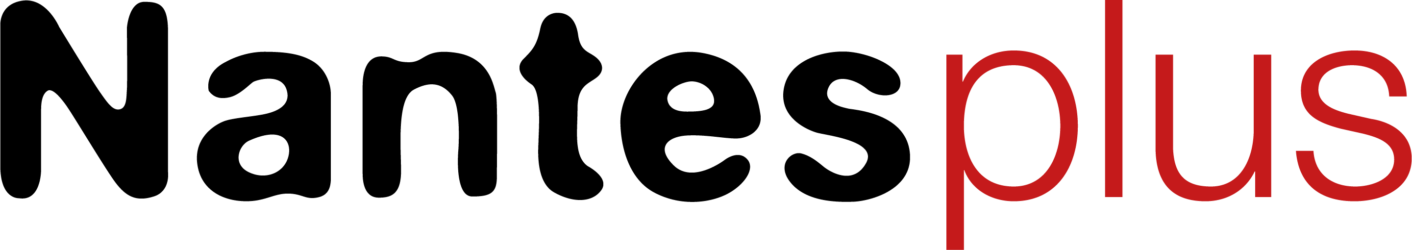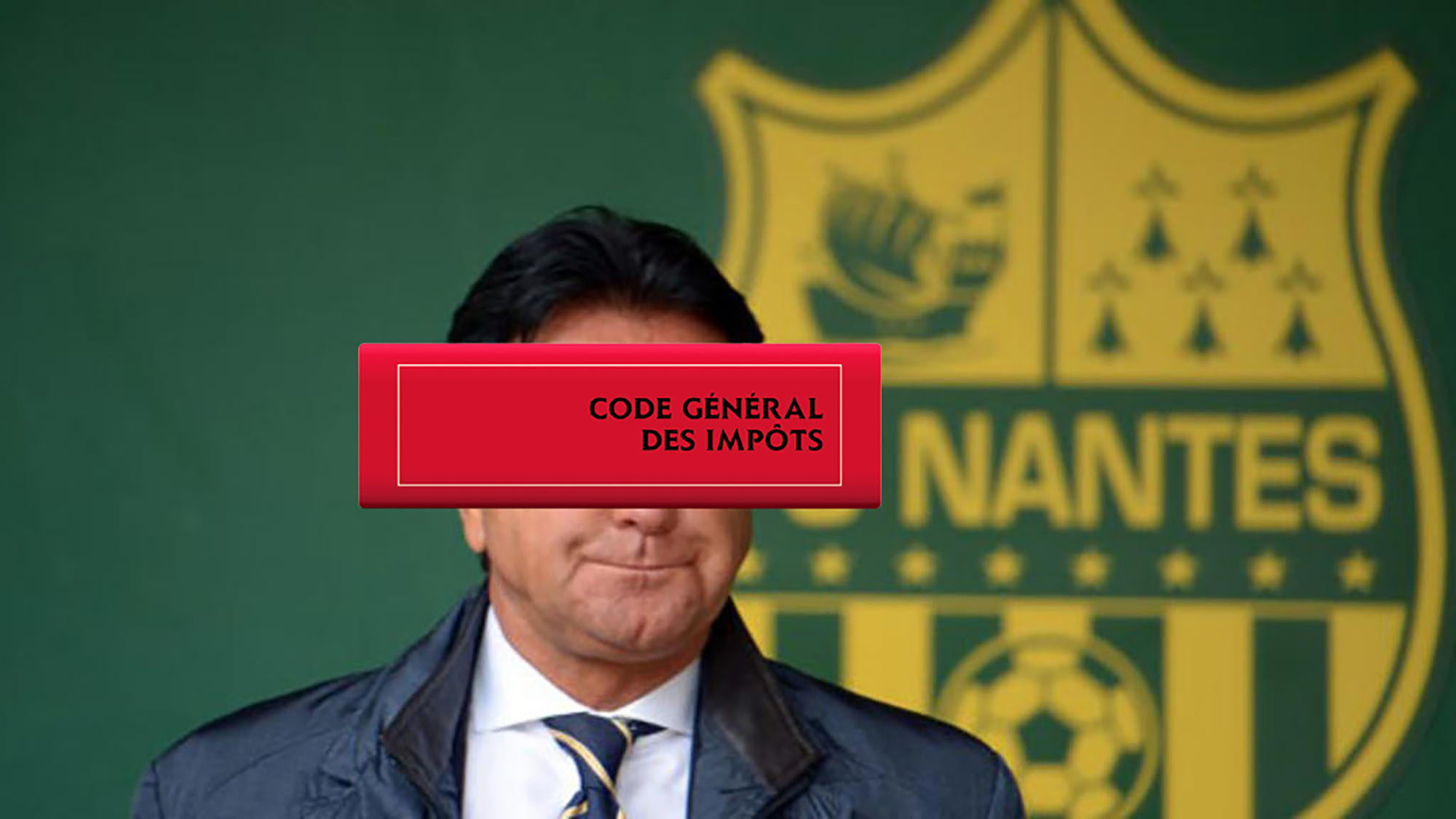De l’audace, toujours de l’audace… Et à Nantes, plus qu’ailleurs, qui peut le “plus” peut le moins. C’est si vrai qu’après les abandons de Notre-Dame-des-Landes et du YelloPark (deux pas de côté comme dirait Jean Blaise), certains spéculent déjà sur le nouveau chantier du futur (?) CHU. Jamais deux sans trois ?
La Métropole se félicite déjà de présenter “le plus gros projet d’établissement public de santé de France”. À l’état de projet, on en est déjà au milliard d’euros. L’expérience de ce type de chantier peut laisser craindre, au bout des comptes, un dépassement de 25%. Ouest-France nous précise le poids du bébé : 30kg de dossiers divers. Un chiffre qui paraît juste un peu léger lorsqu’on apprend par ailleurs qu’une cinquantaine de personnes travaillent “à temps plein” sur le dossier depuis deux ans.
Avant l’enquête, les travaux continuent
Si le cœur vous en dit, vous pourrez consulter cette masse de documents à partir du 25 mars puisque c’est à cette date que sera ouverte l’enquête publique. Pas besoin d’en attendre les résultats pour commencer les travaux : sondages et terrassements vont bon train depuis plus d’un an, le long de la Loire, sur le site du futur CHU. C’est dire l’importance de la future enquête… À celles et ceux qui ont mis en avant accessibilité, crainte d’inondations, survol d’avions se dirigeant vers Nantes Atlantique, on se bornera à répéter que tout est parfaitement maîtrisé.
Il est ainsi rappelé que le niveau zéro du futur hôpital resterait, en cas de crue millénaire, “40 cm au-dessus de l’eau”. A-t-on pris en compte le réchauffement climatique, la fonte des glaciers et sa répercussion sur le niveau des eaux ? Ou bien a-t-on étudié les crues du siècle dernier qui avaient provoqué l’évacuation de certaines maisons de Trentemoult ? Allez savoir… Toujours est-il qu’on indique qu’en cas de crue “les deux ponts sur la Loire demeureraient hors d’eau” et que “l’hôpital resterait accessible par hélicoptère”. Défense de rire. Si c’est la directrice adjointe de l’hôpital qui le dit, pourquoi en douter ?
Les autres points noirs concernant le futur équipement sont balayés avec la même tranquillité. Mieux, ceux-là même qui plaidaient hier le nécessaire transfert de l’aéroport en raison du survol de l’hôpital n’y trouvent plus rien à redire aujourd’hui. On aurait mal entendu. Le futur hôpital serait juste transféré un peu plus proche et un peu plus dans l’axe de la piste de décollage/atterrissage de Nantes-Atlantique mais qu’importe. Quant à l’accessibilité, Nantes Métropole annonce non pas une mais deux lignes de tramway dans un futur qui reste à déterminer. Si leur réalisation prend autant de temps que la desserte de l’aéroport, il faudra se montrer patient. En même temps, les patients ne viennent pas forcément à l’hôpital en empruntant les transports en commun !
Voilà en tout cas un dossier dont les Nantais n’ont pas fini d’entendre parler. Un (ancien) panneau de signalisation devrait faire son retour devant les bien nommées salles de consultation de l’enquête publique : Hôpital Silence. Sans doute est-il encore tôt pour établir le diagnostic final mais une chose est sûre, l’opération s’annonce délicate.