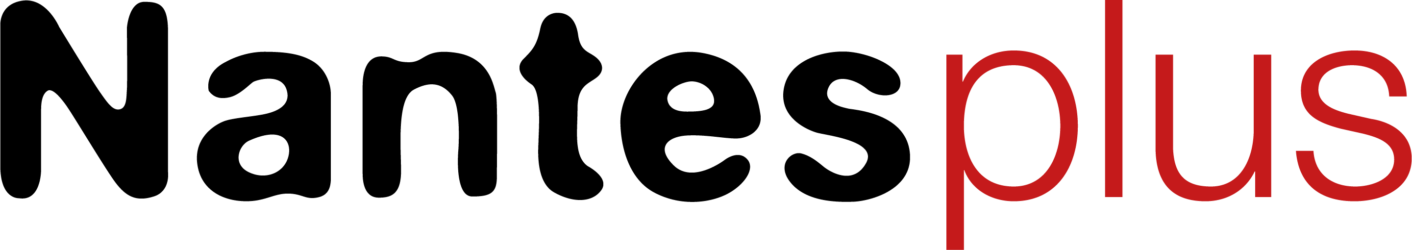René-Théophile Laennec (1781-1826), personnage majeur dans l’histoire de la médecine, devrait être une gloire nantaise presque au même titre que Jules Verne. Or Johanna Rolland et les siens ne semblent pas le connaître ! Saisiront-ils l’occasion de se rattraper en 2026 ?
On commence à se soucier du déménagement de l’hôtel-Dieu. La Ville a lancé à l’automne dernier une « démarche d’inspiration citoyenne » afin de recueillir des avis sur l’avenir du site bientôt désaffecté. Elle a obtenu tout de même 375 contributions, y compris de très loufoques. Créer un « grand parc nourricier », par exemple, idée émise par Johanna Rolland dès 2020, comme si les sols n’étaient pas pollués à mort ! (Certes, elle pourrait charger ses paysagistes favoris de tout recouvrir de bonne terre, quoi qu’il en coûte : on n’en est plus à ça près.)
Au sein de ce maelström discursif, personne ne paraît s’être préoccupé des œuvres exposées sur un même socle devant la fac de médecine : le buste de René-Théophile Laennec et un médaillon du même et de son oncle Guillaume. Si l’on n’y prend pas garde, un accident serait vite arrivé… Car Laennec semble systématiquement ignoré par la municipalité nantaise actuelle. Le site web de Nantes Métropole évoque la « rue Laennec » ou l’« hôpital Laennec », jamais le personnage lui-même.
Nantes devrait pourtant voir en René-Théophile Laennec (1781-1826) un solide atout pour sa réputation internationale. Le docteur Charles Le Séac’h, longtemps président du conseil de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique au siècle dernier, racontait volontiers cette histoire :
En 1942, une grave épidémie sévit dans le Stalag IVB, gros camp de prisonniers de guerre situé à Mühlberg, dans l’est de l’Allemagne. Un célèbre professeur de médecine viennois est appelé en consultation. On commence par lui présenter les effectifs médicaux du camp, allemands et captifs. Quand on lui dit que je viens de Nantes, il s’exclame : « Nantes ! La ville de Laennec ! » Un médecin militaire boche tente de se faire remarquer : « Ach ! Laennec ! Das Stethoskop ! » Le professeur le fusille du regard : « Oui, le stéthoscope, et tout le reste de la médecine aussi ! »
Car, avec son Traité de l’ auscultation médiate, ouvrage connu dans le monde entier, Laennec a fait faire un pas de géant aux méthodes de diagnostic médical. Il a aussi marqué d’autres domaines que la phtisiologie ; il est par exemple le créateur des mots « cirrhose » et « mélanome ». Rudyard Kipling a même fait de lui l’un de ses personnages. Or sa vocation médicale est née sur les bords de la Loire : originaire de Quimper, il est arrivé à l’âge de 7 ans à Nantes, où il a été élevé par son oncle Guillaume Laennec (1748-1822), lui-même célèbre personnalité médicale, directeur de l’École de médecine. Il a commencé sa formation auprès de lui avant de poursuivre ses études à Paris.
Une bourde du Dictionnaire de Nantes
L’étonnante indifférence de la municipalité nantaise peut résulter en partie de l’une des nombreuses erreurs du Dictionnaire de Nantes, largement financé par elle-même (l’un de ses quatre auteurs principaux disait avoir été « très correctement payé »). Selon l’article consacré à Laennec par Alain Croix, « l’illustre inventeur du stéthoscope en 1816 n’a de lien avec Nantes que d’avoir été élevé par son oncle Guillaume, mais il quitte la ville à seize ans, affecté déjà à l’hôpital militaire de Brest ». Laennec a bel et bien été nommé aide-chirurgien de 3e classe à l’Armée des côtes de Brest. Mais le territoire de celle-ci couvrait l’ensemble de la Bretagne et son principal établissement de santé, l’Hôpital de la Paix, se trouvait à Nantes, dans l’église Saint-Clément ; il avait pour médecin-chef… l’oncle Guillaume !
Le site municipal Patrimonia le reconnaît sans détour : « des savants à l’aura nationale ou internationale, comme Clémence Royer et surtout René Laennec, ont bien leur rue et même, pour le second, un buste à l’entrée de la faculté de médecine, mais leur lien avec la ville est second ». Encore ledit buste est-il le fruit d’une initiative privée lancée par le doyen Kernéis pour le bicentenaire de la naissance du savant en 1981. Il est d’autant plus précieux qu’il reproduit une œuvre du sculpteur nantais René Toulmouche (1805-1890) donnée à l’université de Nantes… mais disparue dans les années 1990. Un autre sculpteur nantais, Jorj Robin (1904-1928), membre des Seiz Breur, a lui aussi réalisé un buste de Laennec, édité à Quimper par la faïencerie HB, et encore disponible à ce jour. Le médaillon des Laennec oncle et neveu reproduit un dessin du peintre nantais Jean Bruneau.
Politiquement pas très correct
Les autres hommages publics à Laennec sont plus anciens encore. La rue Laennec, ancienne voie privée devenu publique, dans le quartier de la Madeleine, a reçu son nom lors de la séance du conseil municipal du 21 mai 1890, avec ce commentaire : « On s’étonne que le nom illustre de Laënnec n’ait pas encore été inscrit sur les noms de notre ville. Il est gravé dans les mémoires. » On ignore si le conseil songeait à Guillaume, qui fut l’un des siens, ou à René-Théophile. Dans ses Notices sur les rues, ruelles, cours, impasses, quais, ponts, boulevards, places et promenades de la Ville de Nantes, Édouard Pied semble pencher pour le premier. La plaque commémorative posée sur l’immeuble où habitaient les Laennec, 5 place du Bouffay, est ancienne également.
Laennec a été, en 1879, le premier médecin dont le nom ait été donné à un hôpital parisien. À Nantes, l’ancien hôpital Laennec a reçu son nom en 1927, et l’a « légué » en 1984 au nouvel hôpital Nord, devenu Hôpital Guillaume et René Laennec. Autre signe d’ignorance puisque le prénom usuel du second était Théophile et non René. Au passage, on note que Nantes écrit souvent « Laënnec », ignorant que Laennec et sa famille n’utilisaient jamais le tréma, étranger à l’écriture traditionnelle des noms bretons.
Le centenaire de la mort de Laennec le 13 août 1826 a été marqué par différents hommages. La Poste, par exemple, lui a consacré un timbre. Il serait temps pour une maire de Nantes en quête d’image de songer à une célébration le 13 août 2026. Hélas, Laennec était fervent catholique et, semble-t-il, plutôt monarchiste : le premier titre de gloire rappelé sur sa tombe, à Ploaré, est qu’il a été le médecin personnel de S.A.R. la duchesse de Berry. Pour avoir vu fonctionner la guillotine place du Bouffay, il avait la Révolution en horreur. Cerise sur le gâteau, il a choisi comme héritier et continuateur son cousin Mériadec, gendre de Pierre-Suzanne Lucas-Championnière, l’un des seconds de Charette, le plus coriace adversaire de la République pendant les guerres de Vendée. Johanna Rolland devra faire preuve d’un peu d’abnégation pour prononcer son éloge.
Sven Jelure
Partager la publication "Nantes redécouvrira-t-elle Laennec avant 2026 ?"