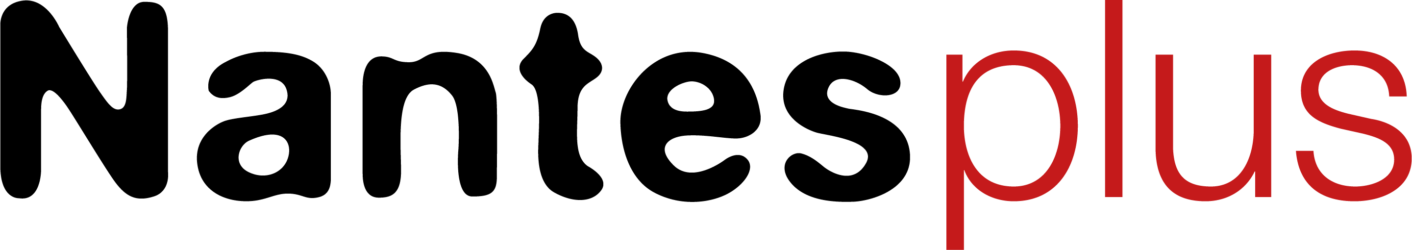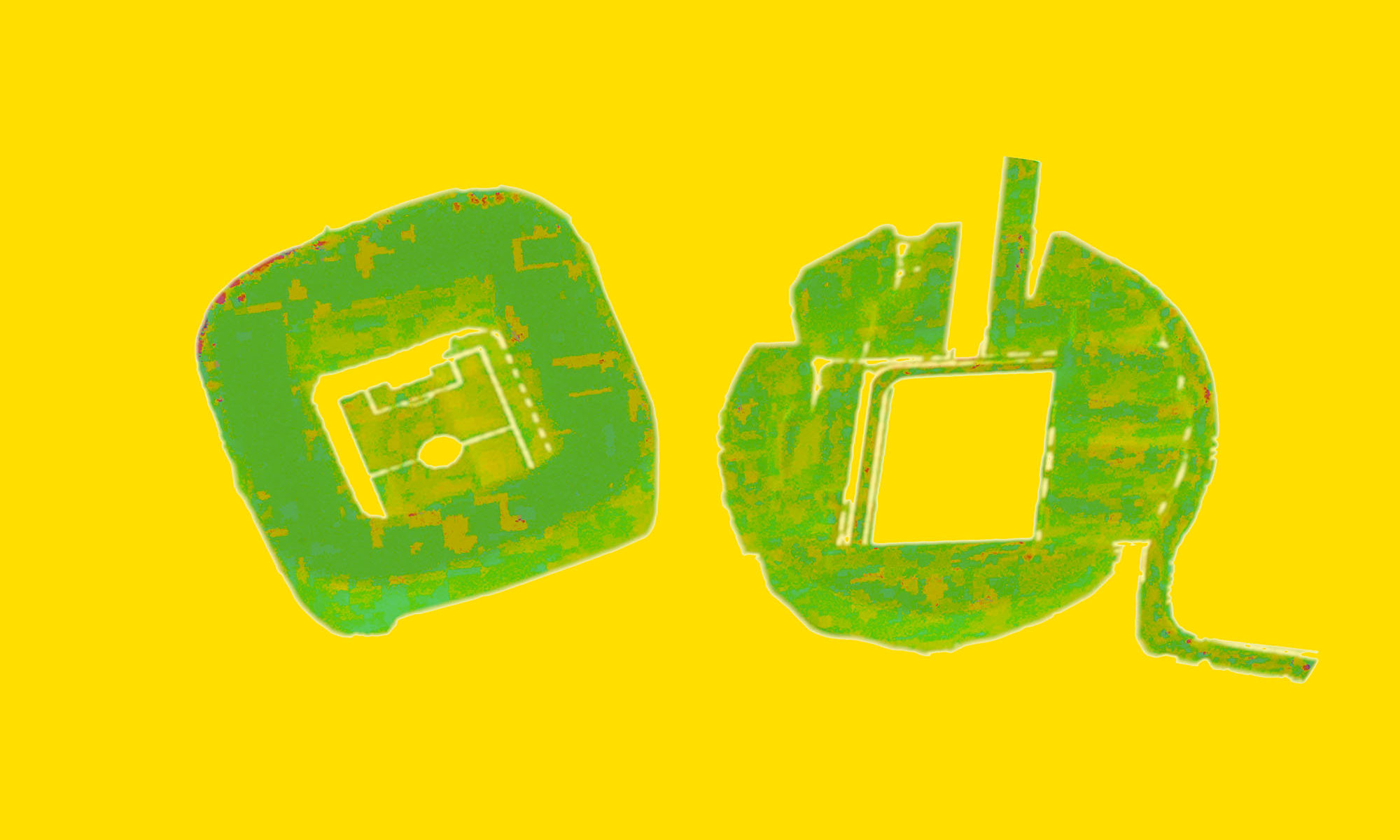La SoNantes est un « échec cuisant » : interrogé récemment par Antony Torzec, de Médiacités, Pascal Bolo n’a pu qu’admettre la triste vérité sur notre monnaie locale « complémentaire ». Mais c’est la faute à pas d’chance, tente-t-il de plaider :
« Entre le moment de l’invention de la SoNantes, c’est-à-dire après la crise financière de 2008-2011, et son lancement en 2015, il n’y avait plus de crise financière. On a donc offert aux entreprises une solution pour résoudre un problème de liquidités qu’elles n’avaient plus. »
De la part de l’homme en charge des finances de Nantes Métropole, cette position est quadruplement fantaisiste.
1) Sur le plan de l’économie. Dans leur immense majorité, les économistes parlent d’une crise de 2008-2009, pas d’une crise de 2008-2011. Lui rajouter deux années apparaît comme une astuce (grossière) pour faire croire que « l’invention de la SoNantes » est venue dans la foulée, en 2012, et qu’il ne s’est écoulé « que » trois ans entre cette invention et son lancement fin avril 2015. Même ainsi, si vraiment on voulait « offrir » aux entreprises une solution à un problème qui se posait en 2008-2011, elles ont largement eu le temps de casser leur pipe.
2) Sur le plan de la chronologie. La géniale invention est en fait bien antérieure à 2012. « L’idée d’une monnaie locale à Nantes n’est pas nouvelle », écrivait début 2015 un observateur bien informé. « Dès 2007, le sujet des monnaies locales est en débat, suscitant l’intérêt des citoyens et des élus nantais. » Oui, dès 2007 : cet aveu est encore lisible aujourd’hui sur… le site web de Nantes Métropole ! En réalité, l’idée remonte même à 2006, comme l’a dit Pascal Bolo lui-même, au conseil municipal du 19 décembre 2014. Entre missions de réflexion et voyages d’études en Suisse et en Italie, il a fallu plus de huit ans, et moult dépenses, pour la concrétiser à toute petite échelle.
3) Sur le plan du diagnostic. La crise de 2008-2009, 2011 si l’on y tient, était une crise bancaire, suivie d’une crise économique, pas une crise de liquidité. Le quantitative easing pratiqué par les banques centrales dès l’été 2008, après la chute de Lehman Brothers, a justement servi à écarter un problème de liquidité. « L’invention de la SoNantes », si elle avait été postérieure à 2008-2011, aurait donc été largement en retard sur l’événement.
4) Sur le plan des objectifs. En réalité, la SoNantes n’a jamais eu pour but d’assurer la liquidité des entreprises. Comme Pascal Bolo l’expliquait au conseil municipal du 19 décembre 2014, elle visait à fluidifier et accélérer les échanges tout en soutenant le commerce et les producteurs locaux. En effet, la SoNantes n’est utilisable qu’à Nantes, entre adhérents au système. Si l’on en reçoit et qu’on ne peut la dépenser nulle part, on est coincé. À cet égard, elle est l’inverse de la liquidité ! (« Dans les prisons d’SoNantes, l’ann didou didou d’ann… », etc.)
Quelques milliers de SoNantes en circulation ne sont même pas une goutte d’eau dans la liquidité en regard des milliers de milliards de dollars et d’euros déversés sur le système bancaire au nom de l’assouplissement quantitatif. D’ailleurs, si Nantes et le Crédit municipal avaient en tête la liquidité des entreprises, pourquoi avoir coupé le robinet, pourquoi ne pas continuer à claquer de l’argent après avoir consumé 2 millions d’euros en pure perte ? On en est maintenant aux économies les plus mesquines. Le site web Une monnaie pour Nantes, longtemps fer de lance de la propagande municipale en faveur de la SoNantes, a laissé la place à un site porno.
Reste à espérer que la liquidité qui a manqué à la SoNantes ne déferlera pas sur l’autre grand projet de Pascal Bolo, le nouveau CHU. Heureusement, ce n’est pas parce que l’un est à sec que l’autre est inondable.
Sven Jelure