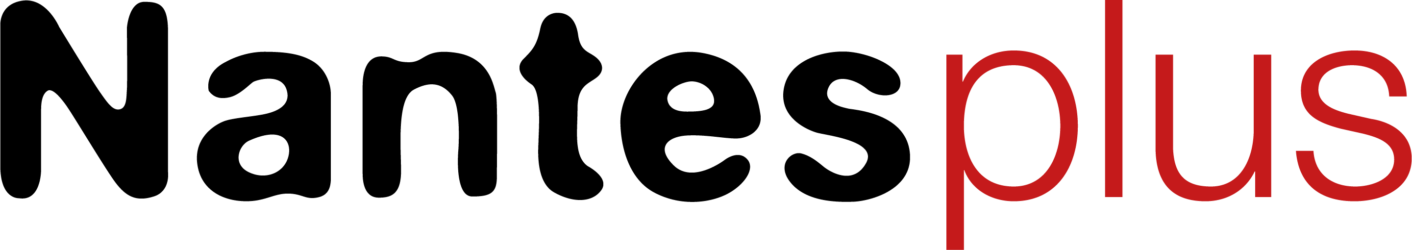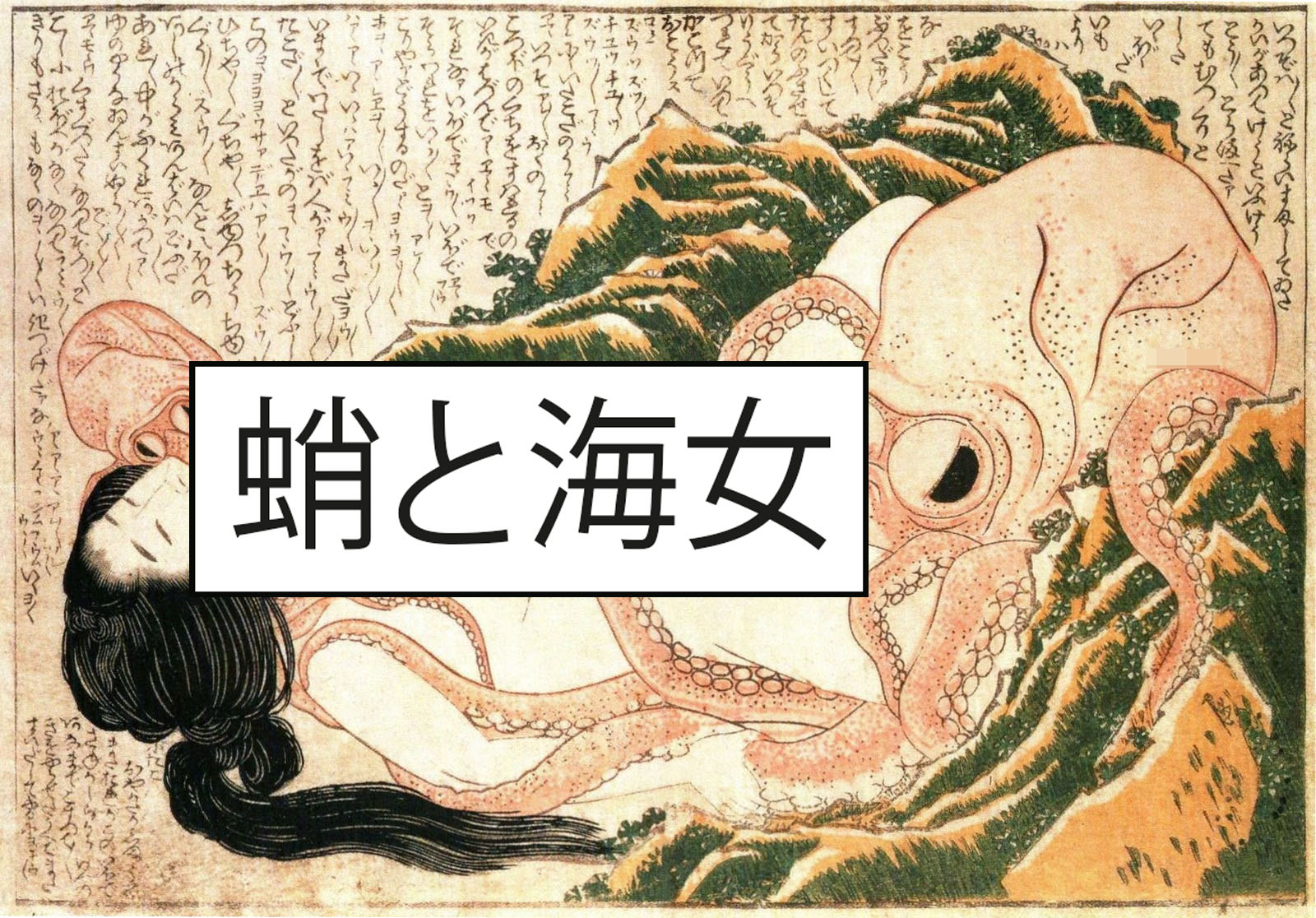Engager une campagne électorale avec une déclaration d’amour plutôt qu’une déclaration de candidature, voilà une démarche sympathique ! C’est ce que vient de faire Foulques Chombart de Lauwe, probable candidat de la droite nantaise à l’élection municipale de 2026, avec son Abécédaire d’un amoureux de Nantes.
Pour originale qu’elle soit, l’initiative n’est pas la première du genre. Elle a été précédée par le Dictionnaire amoureux de Bordeaux d’Alain Juppé en 2018. Maire de la ville depuis 2006, l’ancien Premier ministre préparait clairement l’élection municipale de 2020, qui se présentait mal. Finalement, Alain Juppé a préféré fuir le combat en saisissant l’opportunité d’une nomination au Conseil constitutionnel en 2019. Son héritier désigné, Nicolas Florian, a été sévèrement battu. L’amour n’a pas fait le poids.
L’inconvénient du langage amoureux, c’est qu’il se compose surtout d’éloges. Alain Juppé ne manquait pas de mots doux pour ce qu’il avait lui-même fait à Bordeaux en quatorze ans de mandat municipal. L’exercice est plus délicat pour Foulques Chombart de Lauwe, bien obligé de glisser malgré tout quelques compliments sur l’Arbre aux Hérons (« ambitieux projet », p. 21), Jean-Marc Ayrault (« maire développeur », p. 26), la politique culturelle (« pari réussi », p. 62), l’École des beaux-arts (« superbes nouveaux locaux », p. 69), l’Institut d’études avancées (« lieu magnifique », p. 98) et même la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (« unique exemple survivant du bocage des années 1970 »)…
Pour l’essentiel, tout de même, il donne dans l’amour vache, faisant la part entre ce qui est propre à Nantes (bien) et ce que lui ont fait des municipalités socialistes et al. depuis 1989 (pas bien, voire pas bien du tout). Les articles CHU (p. 49), Circulation (p. 52), Démocratie municipale (p. 63), MIN (p. 118) ou Sécurité (« le gros boulet de l’équipe municipale », p. 147), flinguent dur : qui aime bien châtie bien.
Une première édition à compléter
Certaines entrées auraient mérité d’être mieux délimitées. Ainsi de l’article Machines de l’île / Royal de Luxe, propre à susciter le courroux de Courcoult puisque les deux entités ‑ une partie d’une société publique locale et une association loi de 1901 ‑ n’ont aucun lien entre elles, sinon que l’inspiration de la première est due à deux transfuges de la seconde. Pour couronner le tout, l’article englobe dans le même mouvement une troisième entité indépendante, l’association La Machine, du « génial François Delarozière », principal fournisseur des Machines de l’île, ainsi que l’Arbre aux Hérons, propriété de Nantes Métropole.
Plus généralement, plusieurs sujets à peine évoqués dans une entrée consacrée à autre chose auraient sans doute mérité un article spécifique. Manquent ainsi Blaise (résiduel sous Voyage à Nantes), Bombardements (alors que Comblements y est), Cinquante otages (signalés sous Comblements), Cité des congrès (traité sous Folle journée), Donateurs (les oubliés d’Arbre aux Hérons, comme Mécènes), François Ier (cité sous Anne de Bretagne), François II (idem), Nantes Atlantique (glissé sous Château Bougon), Police municipale (expédié sous Sécurité), Tour Bretagne (instrumentalisé sous Bretagne)… Si Ayrault a droit à une entrée à lui, pas les autres maires de Nantes ‑ Morice, Chénard, Chauty, Rimbert et même Rolland !
À l’article Culture, Foulques Chombart de Lauwe ne se montre pas un amoureux bien assidu. Il signale cinq écrivains et trois peintres mais zéro sculpteur et zéro compositeur. Le mouvement artistique des Seiz Breur, si actif à Nantes entre les deux guerres, n’est pas mentionné. Et si Elmer Food Beat a droit à un article, tout comme Barbara (contemptrice du climat nantais, que pas un maire n’aurait eu l’idée d’honorer si elle n’avait été une amie du président Mitterrand), les Tri Yann en sont privés ! Au fil de l’abécédaire, on rencontre aussi Gracq à la lettre G et Alain Thomas à la lettre T, mais Jules Verne est classé sous J, René Martin sous R et William Turner sous W.
Quand le vin de Loire est tiré…
Les vins d’ici sont globalisés sous la seule entrée Vins. Soit. Pourtant, il aurait été bon de rappeler que l’AOC exacte du gros-plant est « gros-plant du Pays nantais ». Mentionner le grolleau, « fort sympathique », est bienvenu, mais pourquoi ignorer l’abouriou, qui fait un retour remarqué ? Il aurait utilement pris la place de « l’ambroisie » : la substance divine de l’Olympe n’est pas produite chez nous, sauf comme un nom de marque commerciale ‑ chez Ménard-Gaborit à Monnières, par exemple. Horrible soupçon : cet intrus de l’Abécédaire serait-il le fruit d’une confusion avec le malvoisie des Coteaux d’Ancenis ?
Mais là où l’amoureux se tire vraiment une balle dans le pied, c’est à l’article Bretagne. « Nantes est-elle ou non en Bretagne ? » commence-t-il. Son sort est ainsi réglé dès la première ligne : cette question bateau n’est posée, rhétoriquement, que par ceux qui ont l’intention de répondre « non » ou, pire encore, « peu importe ». Tous les poncifs viennent ensuite : la régionalisation vichyste, les châteaux de la Loire (un concept qui ne date pourtant que du 19e s.), les toits d’ardoise et de tuile, l’en-même-temps brito-ligéro-vendéen, etc. Depuis Olivier Guichard, par conservatisme plus que par conviction (« …d’autres priorités à traiter »), la droite nantaise s’est acharnée à pousser vers la gauche le sentiment breton. Or ce sentiment est vif et puissant, alors que pas un Nantais sans doute ne vote au nom d’un sentiment ligérien. Le socialiste Jacques Auxiette, ligérien rabique, a provisoirement repeint la région en rose, mais le doute est levé depuis 2015 : les Pays de la Loire, c’est la droite, et vice-versa. Foulques Chombart de Lauwe, qui fut un collaborateur proche de Christelle Morançais de 2016 à 2019, a au moins le mérite de la fidélité.
On n’en apprécie que davantage l’originalité de l’inspiration, le dynamisme du texte et la qualité de la réalisation. Il y a des phéromones qui se perdent.
Sven Jelure