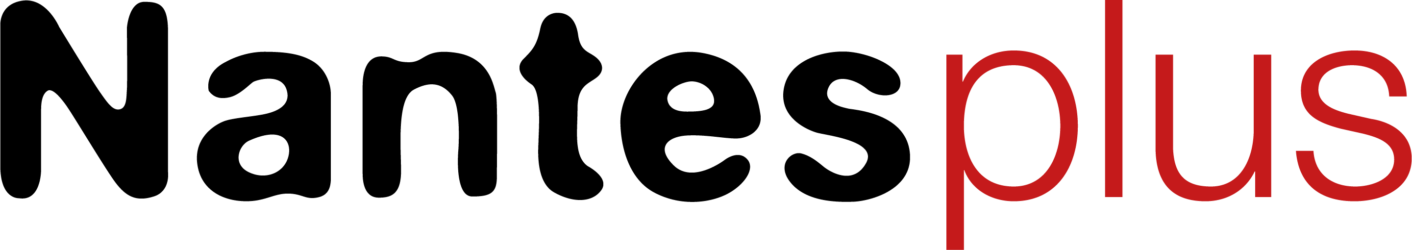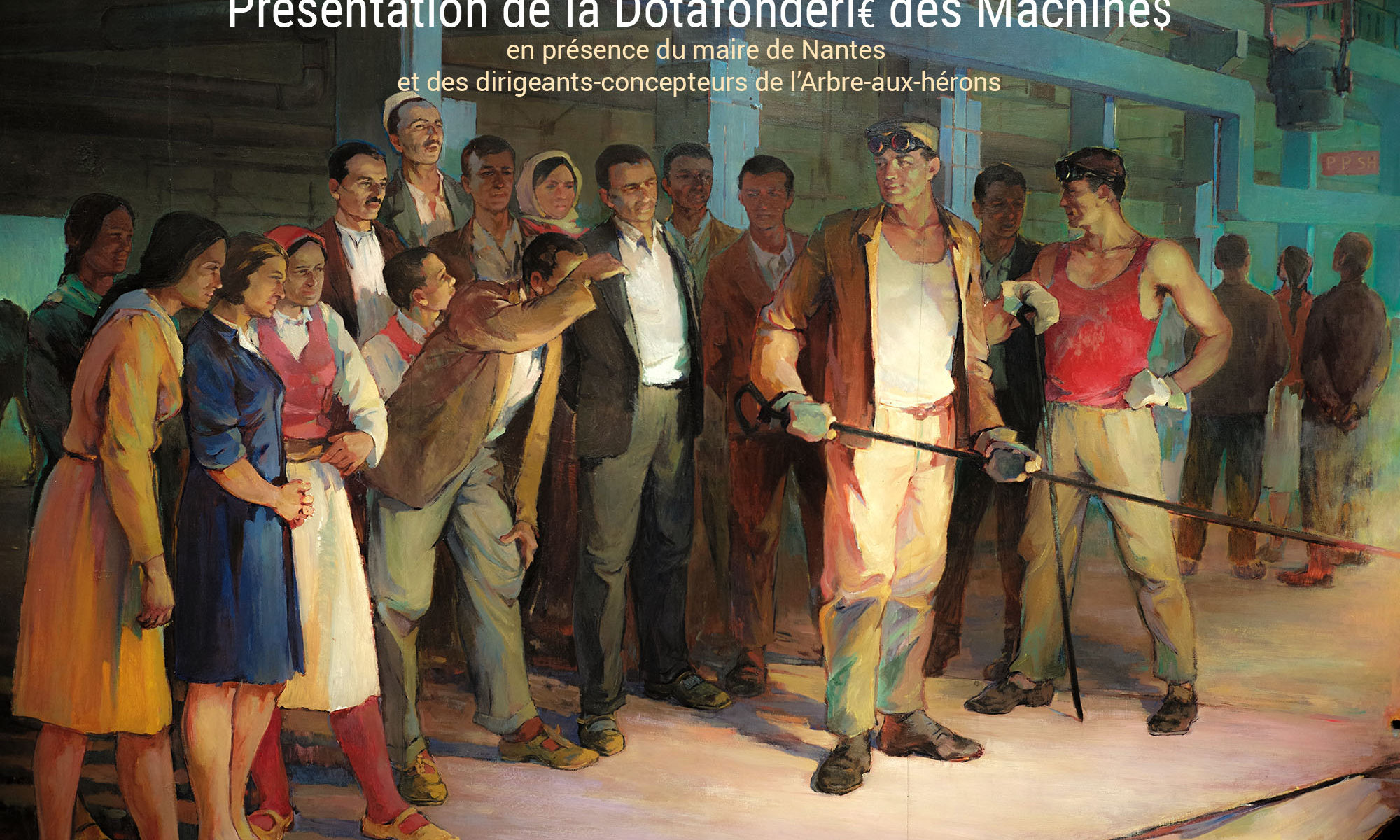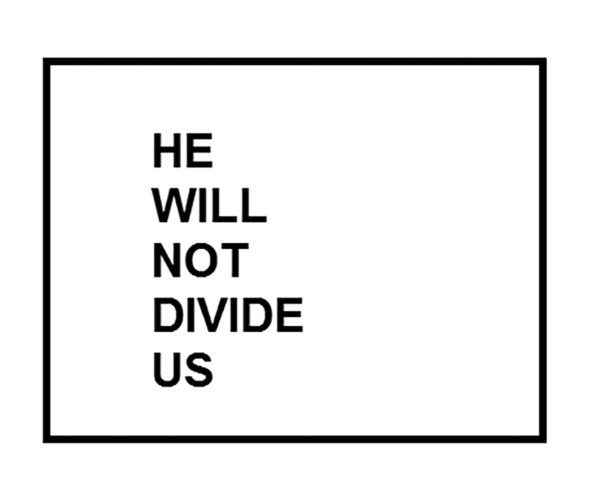La Loi impose aux fonds de dotation de publier leurs comptes au Journal officiel au plus tard six mois après la fin de leur exercice. Le Fonds de dotation de l’Arbre aux Hérons devrait donc publier les siens avant la fin juin. On est impatient de savoir comment leurs aspects les plus acrobatiques auront été traités.
Ainsi, on se rappelle que lors de sa campagne de financement participatif sur Kickstarter, au printemps 2018, le Fonds a promis à ses gros donateurs (1.000 euros) de graver leurs noms sur les bancs des Machines de l’île. Ça n’était toujours pas fait en fin d’année, mais comme les fonds de dotation doivent tenir une comptabilité d’engagement, leurs dettes sont immédiatement inscrites dans leurs comptes. Il sera intéressant de voir comment ces gravures futures ont été comptabilisées au 31 décembre.
Mais il y a mieux encore.
« Nous avons gardé des cartouches pour tenir le buzz », assurait Pierre Orefice en mars 2018, pendant la campagne Kickstarter, en promettant des « Pass ambassadeurs » aux gros donateurs : un don de 500 euros donnait droit à un pass – un abonnement gratuit – pendant dix ans, un don de 1.000 euros à deux pass pendant dix ans. Il y en a au total pour 2.360 années d’utilisation gratuite ! Mais avec ces cartouches, le Fonds pourrait bien s’être tiré une balle dans le pied, ce qui compliquerait les « pas de côté » chers au Voyage à Nantes.
A première vue, la promesse est banale : les récompenses des projets Kickstarter sont souvent les fruits des projets eux-mêmes. Si vous financez la création d’un CD, par exemple, vous recevez un exemplaire du CD. Il s’agit davantage de prévente que de cadeau. Eh bien, quoi ? Vous financez L’Arbre aux Hérons, vous recevez le droit d’y grimper gratuitement pendant dix ans, il n’y a pas de différence avec le CD, n’est-ce pas ? Hélas si :
1) Contrairement à l’éditeur du CD, le Fonds de dotation ne fournira pas lui-même le cadeau. Il a récolté l’argent mais ne gérera pas l’Arbre aux Hérons. Ses promesses devront être tenues par quelqu’un d’autre. Mais elles représentent quand même une dette envers ses donateurs. Comme il tient une comptabilité d’engagement, cette dette a dû être inscrite immédiatement dans ces comptes.
2) La promesse devra être tenue par quelqu’un d’autre. Le Fonds a dû obtenir un engagement de ce « quelqu’un ». Son président, Bruno Hug de Larauze, y a sûrement veillé. Car il est « seul responsable des promesses formulées dans le cadre de son projet », spécifie Kickstarter dans la section 4 de ses conditions d’utilisation. « S’il n’est pas en mesure de respecter les conditions de l’accord, il peut être poursuivi en justice par les contributeurs. »
3) Qui a pu souscrire cet engagement ? On ignore à ce jour qui serait l’exploitant de l’Arbre. Les Machines de l’île font comme si c’était elles. Mais cela supposerait que Nantes Métropole décide d’abord de construire l’Arbre, ensuite de confier sa gestion aux Machines via une délégation de service public à leur propriétaire, la SPL Le Voyage à Nantes. Le Fonds de dotation de l’Arbre aux Hérons a-t-il spéculé sur deux décisions futures du conseil métropolitain ? Ce serait spécialement hasardeux.
4) On pourrait imaginer que Nantes Métropole soit allé plus vite que la musique en promettant au Fonds de tenir ses promesses le jour venu. Mais elle n’aurait pu prendre un tel engagement gratuitement. Comme la gravure sur les bancs, ce serait une subvention en nature, interdite ! Et si elle fait payer l’engagement, le Fonds doit le comptabiliser aussitôt comme une dépense ou comme une dette.
5) Quelle est la valeur l’engagement pris ? Là, c’est facile ! La notion de « pass ambassadeur » renvoie clairement à une formule pratiquée par Les Machines de l’île. Son prix, 38 euros par an, est arrêté par le conseil métropolitain. Si Nantes Métropole soi-même considère qu’un « pass ambassadeur » vaut 38 euros, inutile d’aller chercher plus loin. Il y en a au total pour 2.360 x 38 = 89.680 euros. Presque un quart de la somme totale récoltée sur Kickstarter.
Est-il imaginable que le Fonds de dotation ait fait des promesses en l’air, comme un vol de héron virtuel, sans s’être assurés de bases solides ? Ah ! au pays de Jules Verne et de Neptunus Favet Eunti, aucune audace n’est impossible ! Mais il devra quand même, avant le 1er juillet, les inscrire dans ses comptes annuels publiés au Journal officiel, visés par un commissaire aux comptes et contrôlés par le préfet de Loire-Atlantique. Vu les risques de plantage du dossier, aggravés par l’éventualité d’un bouleversement électoral aux municipales de 2020, il est probable que tous les échelons concernés veilleront à ouvrir le parapluie en se montrant spécialement sourcilleux.
Au fait, pour l’anecdote, on notera que sur la base de 38 euros par an, la valeur des « pass ambassadeur » représente 76 % des montants donnés (380 euros pour un don de 500 euros et 760 euros pour un don de 1.000 euros), soit beaucoup plus que le plafond de 65 euros admis par le fisc pour les réductions d’impôt au titre du mécénat. Cerise sur le gâteau, ce détail aurait dû obliger le Fonds de dotation à payer une TVA sur les sommes recueillies.
Sven Jelure