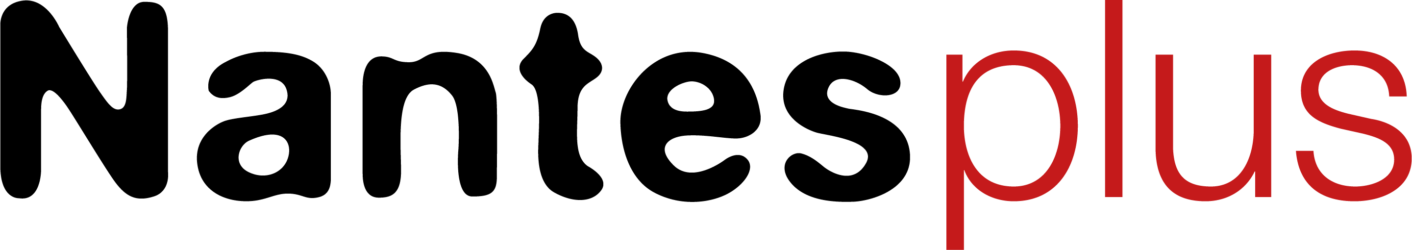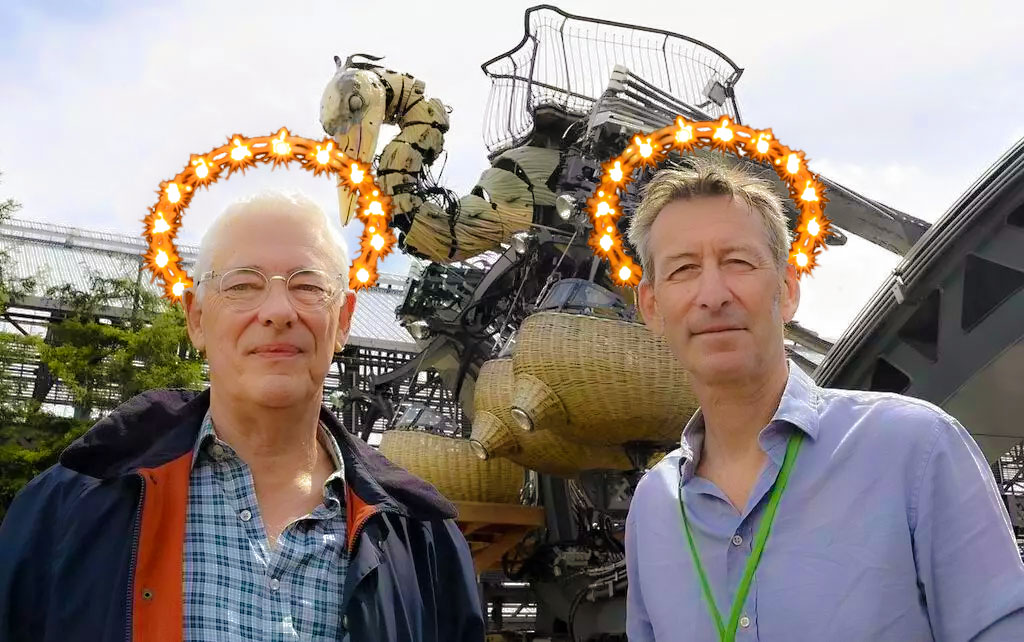Johanna Rolland fait grand cas d’un grand débat à lancer en 2023 sur la « fabrique de la ville ». Des « scénarios de crise » en occuperont le centre. Des scénarios encadrés par Nantes Métropole, certes, donc peu propices aux envolées contestataires. Mais, après le travail sur la communication de crise déjà signalé par Nantes Plus, cette nouvelle démarche propagandiste pourrait dénoter un certain pessimisme dans les hautes sphères municipales.
Parmi les six grandes promesses faites aux Nantais par Johanna Rolland pour 2023 figure « un grand débat sur la fabrique de la ville ». Un sujet capital puisqu’il vient même avant l’annonce d’un spectacle de Royal de Luxe, c’est dire !
Mais qu’est-ce donc qu’une « fabrique » ? Le mot a d’abord signifié « construction d’un édifice religieux », puis a désigné les fonds destinés à cette construction et enfin les responsables de leur administration (le « conseil de fabrique »). Johanna Rolland est trop respectueuse de la laïcité pour parler de « fabrique » dans ce sens-là.
L’autre sens principal du mot, tel que le définit l’Académie française, est celui-ci : « Établissement industriel de petite ou moyenne importance où l’on produit des objets manufacturés ». Ciel ! Nantes Métropole, un établissement de petite ou moyenne importance ? Nantes, un objet manufacturé ? Ce serait bien dévalorisant.
Alors, que veut dire Johanna Rolland par « fabrique de la ville » ? L’Académie française livre entre les ligne une troisième hypothèse à considérer : « Expr. fig. et fam. Cela est de sa fabrique, de son invention ». Autrement dit, la « fabrique de la ville » pourrait être un pur storytelling. Et, on va le voir, cette interprétation propagandiste est fléchée par Nantes Métropole elle-même.
Modèles pas requestionnés
Celle-ci a lancé pas moins de trois appels d’offres sur le sujet ! Le premier est intitulé « Conception et animation d’une offre de dialogue citoyen sur les modes de vie dans le cadre d’un grand débat citoyen sur la fabrique urbaine ». Les conseillers municipaux sont élus pour faire remonter les avis de leurs électeurs ? Sans doute ne s’acquittent-ils pas bien de leur mission puisqu’il faut encore présenter aux citoyens une « offre de dialogue citoyen (…) dans le cadre d’un grand débat citoyen ». Celui-ci devrait se dérouler de mars à juillet 2023.
Comme le note judicieusement l’avis de marché, « il devient de plus en plus ardu de construire la ville sur la base de modèles qui n’ont pas été requestionnés depuis de nombreuses années ». Au hasard, depuis 1989 ? L’ayraultisme est « ardu », c’est bien de le reconnaître. Mais il aurait mieux valu le faire en temps utile. Pourquoi avoir attendu pour s’interroger que le chantier du CHU, entre autres, ait été lancé selon un modèle non « requestionné » ?
Ce grand débat tardif affiche quatre objectifs :
- « Partager une culture urbaine commune ». Étrange ambition. Un débat invite aux désaccords. Il devrait plutôt révéler ce qui n’est pas commun dans la culture urbaine. Mais ce n’est pas l’intention ici. Ce qu’on appelle débat « passera notamment par de la pédagogie auprès des acteurs les plus éloignés des institutions de cette fabrique de la ville ». Autrement dit, on veut faire entrer tout le monde dans le moule de la fabrique à grands coups de « pédagogie », comme on dit quand on veut éviter le mot propagande.
- « Réaffirmer le cap de mutation écologique et sociale ». Pour autant que ce cap ait déjà été affirmé au point de mériter son article défini au singulier.
- « Identifier les leviers d’actions possibles prenant en compte d’une part les modes de vie des habitants de la Métropole dans leur diversité de mode de vie », etc.
- « Renouveler les processus de la transformation urbaine en innovant ». Renouveler la transformation en innovant, n’est-ce pas beaucoup de redondance pour une seule phrase ?
Quant au reste, pas de surprise : parlotes et paperasses jusqu’à la remise d’un document final dans les derniers jours de juillet. Il est probable qu’il sera, selon la coutume, classé assez vite dans un placard.
Cap sur les récits
Le deuxième avis de marché est plus original. Il a pour titre « Animation d’une offre participative sur les récits d’une métropole en transition dans le cadre d’un grand débat sur la fabrique urbaine ». On retrouve le « cap » du premier avis de marché, qu’on considère comme fixé, « mais il s’agit aujourd’hui de pouvoir intégrer un contexte nouveau et mouvant ». Pas si fixé que ça, en somme. L’avis répète néanmoins les quatre objectifs du précédent…
Là, l’idée est de s’adresser aux « habitant.e.s de la métropole » pour « faire émerger par le biais d’un travail basé sur l’imaginaire, des préconisations pour une métropole en transition ». Pas l’imagination, n’est-ce pas, l’imaginaire ! Pas la folle du logis mais la logique de la Métropole. Il s’agit de « générer un imaginaire collectif », sous forme de « récits d’une métropole ». Séduisant, à première vue. Mais on n’oubliera pas que, dans les milieux de la communication contemporains, le mot « récit » (ou « narratif »dit-on parfois en refrancisant bêtement l’anglais « narrative »… lui-même venu du français*) camoufle est lui aussi un moyen d’éviter le mot « propagande ».
Et en effet, l’« offre participative » de Nantes Métropole se rapproche dangereusement du bourrage de crâne. Au minimum, le risque de « préconisations » politiquement incorrectes est nul. Car cet imaginaire ne sera pas constaté mais « généré », fabriqué en somme, à l’aide de quatre « escape game » (sic), quatre « scénarios de projections ».
Ceux-ci « auront pour but de ne pas être directifs mais d’ouvrir le champs (sic) des possibles, des imaginaires », assure Nantes Métropole, qui ne craint pas les oxymores. Car un scénario est directif par nature ! Retour à l’Académie française : c’est un « développement attendu ou supposé d’une action dans le temps ». Les scénarios seront téléphonés d’autant plus sûrement que leurs thématiques seront définies « lors de la réunion de cadrage », c’est-à-dire choisies par Nantes Métropole.
Cette dernière, cependant, ne tombe pas dans l’optimisme béat : les scénarios proposés par le prestataire retenu dans le cadre du marché seront des scénarios de crise. Au singulier ou au pluriel, le mot « crise »figure vingt-trois fois dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’avis de marché. Décidément, Nantes Métropole est obsédée par les crises ! Son vécu récent n’inspire peut-être pas à Johanna Rolland un optimisme éclatant.
Controverses encadrées
On a quand même dû s’apercevoir en haut lieu qu’un grand débat sans matière à débat allait faire désordre (ou plutôt excès d’ordre). À retardement, Nantes Métropole vient de publier un troisième appel d’offres, intitulé cette fois « Animation d’une offre participative sur les controverses contemporaines de la fabrique urbaine métropolitaine dans le cadre d’un grand débat ».
Celui-ci, assure-t-on un peu tard, « n’a pas pour objectif de mettre tout le monde d’accord ». C’est un débat, quoi ! Le prestataire retenu devra donc « mettre en débat et en perspective les principales controverses contemporaines qui traversent le débat public sur les questions urbaines et la fabrique de la ville à l’échelle métropolitaine ». On va donc écouter les citoyens qui ont des désaccords à formuler ! Enfin… pour autant que Nantes Métropole soit d’accord sur les désaccords, car « les sujets de controverses proposés au débat seront choisis par le commanditaire » !
Et ce commanditaire ne compte pas se montrer trop gourmand : « il est envisagé d’organiser 4 à 5 ateliers portant chacun sur une controverse différente » et d’une durée maximum de 2h30. La grandeur d’un débat ne doit pas se juger à sa quantité !
Alors, sur quels sujets de qualité les Nantais pourront-ils controverser ? « À titre d’exemple », Nantes Métropole indique déjà cinq sujets, qui suffisent à absorber les marges de manœuvre : « l’urbain est-il un business ou un placement comme un autre ? », « la ville sobre est-elle forcément moche ? », « la propriété immobilière est-elle le seul horizon souhaitable ? », etc. Ça c’est de la controverse, et pas du tout téléphonée, hein !
Sven Jelure
* Pour mieux apprécier l’utilité d’un « narratif » dans une « métropole en transition », livrons d’avance au débat ce résumé d’un article scientifique publié en 2020 dans Les Nouvelles de l’archéologie :
La multiplicité et la diversité des entités et processus impliqués dans les grandes transitions demande des choix narratifs pour les rendre intelligibles, choix qui exigent de recourir à des concepts combinant les capacités d’action des humains et des non humains. La notion de médiant, ou « combinaison transhumaine catalysant des changements profonds » – les techniques et institutions associées, leurs modes d’appropriation et leurs effets –, pourrait être au cœur de ces narratifs, en précisant les enjeux scientifiques des grandes transitions.
L’auteur de ce texte, Denis Couvet, est aujourd’hui président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité…