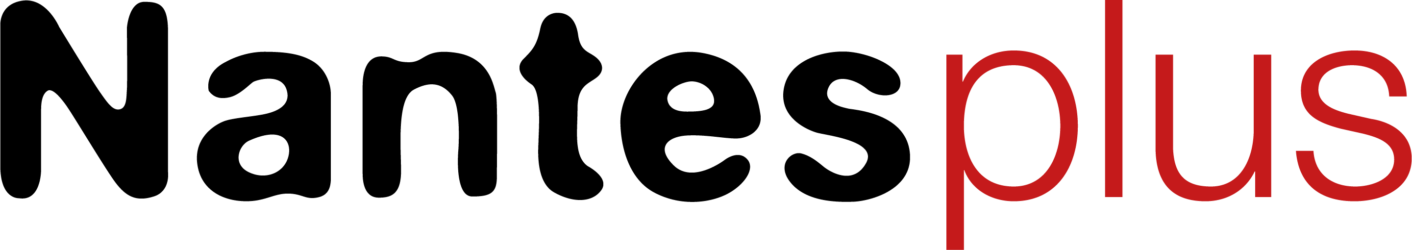L’intelligence artificielle générative est la vedette du moment. ChatGPT a même eu les honneurs du dernier conseil de Nantes Métropole. Mais que sait-il lui-même de Nantes ? Une courte exploration révèle qu’il peut se montrer d’une étonnante crédulité. Ou bien serait-ce de la duplicité ?
Dans la foulée de notre article sur la monnaie locale SoNantes/Moneko, nous avons demandé à ChatGPT quelles leçons il retenait de cette aventure pour Pieds-nickelés de la finance. Voici notre dialogue :
Nantes+ : Pascal Bolo a-t-il joué un rôle dans la création de la monnaie complémentaire locale SoNantes ?
ChatGPT : Je suis désolé, mais je ne dispose pas d’informations sur un éventuel rôle de Pascal Bolo dans la création de la monnaie complémentaire locale SoNantes. Cependant, je peux vous dire que la création de la monnaie SoNantes a été initiée en 2011 par un groupe de citoyens engagés de Nantes, en France, avec pour objectif de favoriser les échanges locaux et de soutenir les acteurs économiques locaux. Depuis sa création, la monnaie SoNantes a connu un certain succès et est devenue un outil de développement économique et social de la région nantaise.
Ainsi, ChatGPT en sait encore moins qu’on ne l’aurait cru. Il ignore que la SoNantes s’est crashée. Il ne connaît même pas Pascal Bolo. (Ou peut-être préfèrerait-il ne pas le connaître, comme le Parti socialiste d’aujourd’hui.) Fin de l’histoire, donc ? Pas si vite ! N’oublions pas que ChatGPT est un système américain. Répétée en anglais, la question reçoit une réponse fort différente :
Nantes+ : Did Pascal Bolo play a significant role in the creation of the local currency SoNantes?
ChatGPT : Yes, Pascal Bolo played a significant role in the creation of the local currency SoNantes. Pascal Bolo is a French politician who was the deputy mayor of Nantes from 2008 to 2014 and was responsible for economic development and employment. In 2011, he supported the initiative to create the local currency SoNantes and played a key role in its development and implementation. He helped to mobilize local businesses and organizations to participate in the project, and he also provided financial and institutional support to ensure its success. Thanks in part to his efforts, SoNantes has become a successful example of a complementary currency, promoting local economic development and sustainability in the Nantes region.
Inconnu en français, Pascal Bolo devient un héros de l’économie locale en anglais ! ChatGPT en sait-il davantage en anglais qu’en français ? Ou bien, face à un interlocuteur francophone, a-t-il délibérément dissimulé une information dérangeante ? Cette hypothèse complotiste n’est pas si absurde car, si l’on pose à nouveau la question en français, ChatGPT (conscient de s’être trahi ?) donne désormais mot pour mot la même réponse qu’en anglais :
Nantes+ : Pascal Bolo a-t-il joué un rôle dans la création de la monnaie locale complémentaire SoNantes?
ChatGPT : Oui, Pascal Bolo a joué un rôle important dans la création de la monnaie locale complémentaire SoNantes. Pascal Bolo est un homme politique français qui a été adjoint au maire de Nantes de 2008 à 2014 et était responsable du développement économique et de l’emploi. En 2011, il a soutenu l’initiative visant à créer la monnaie locale complémentaire SoNantes et a joué un rôle clé dans son développement et sa mise en œuvre [etc.]
ChatGPT persiste néanmoins à tenir pour « successful » une affaire qui n’a pas duré trois ans. Alors, soyons plus explicites dans notre question :
Nantes+ : Pascal Bolo a-t-il joué un rôle dans l’échec de la monnaie locale complémentaire SoNantes?
ChatGPT : Je ne dispose pas d’informations indiquant que Pascal Bolo a joué un rôle dans l’échec de la monnaie locale complémentaire SoNantes. En réalité, la monnaie SoNantes a connu un certain succès et est devenue un outil de développement économique et social de la région nantaise [etc.]
Ainsi, ChatGPT ne veut même pas entendre parler d’un échec ! Soyons donc encore plus explicites :
Nantes+ : Pourquoi le quotidien « Presse Océan » a-t-il qualifié la monnaie locale complémentaire SoNantes de « fiasco » (13 novembre 2017) ?
ChatGPT : Le quotidien Presse Océan a qualifié la monnaie locale complémentaire SoNantes de « fiasco » dans un article publié le 13 novembre 2017 en raison de la fermeture de l’association qui la gérait à l’époque. Selon l’article, l’association a été contrainte de cesser ses activités en raison de problèmes financiers, notamment en raison d’une baisse significative du nombre de commerçants acceptant la monnaie SoNantes. Le journal a également souligné que la monnaie avait été confrontée à des problèmes de gestion, notamment en termes de sécurité et de transparence.
Cependant, il est important de noter que la monnaie SoNantes a connu un certain succès avant cette fermeture, avec plus de 300 entreprises adhérentes et plus de 35 000 SoNantes en circulation. La fermeture de l’association n’a donc pas été la fin de l’histoire de la monnaie SoNantes, qui a été reprise par une nouvelle association en 2018 et continue de fonctionner aujourd’hui avec un certain succès. Comme pour toutes les initiatives innovantes, les monnaies locales complémentaires peuvent rencontrer des défis et des difficultés, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles sont un « fiasco ».
Ici, ChatGPT bidonne carrément. L’article du 13 novembre 2017 n’évoquait pas une baisse du nombre de commerçants (lequel augmentait, quoique très lentement) mais un échec du système de troc interentreprises. Il n’était pas question de « fermeture de l’association qui la gérait », et pour cause : cette association existe toujours en 2023, elle a juste changé de nom, devenant MLC44 au lieu de La Sonantaise. ChatGPT n’est même pas capable de calculer que 35 000 SoNantes pour 300 entreprises, cela fait moins de 117 SoNantes par adhérent en moyenne : et c’est cela qu’il appelle « un certain succès » ? On dirait que toute information désobligeante envers l’initiative monétaire de la municipalité nantaise est résolument écartée. La langue anglaise sera-t-elle plus loquace ?
Nantes+ : Why did the local daily « Presse Océan » (11/13/2017) call the local currency SoNantes a « fiasco »?
ChatGPT : I’m sorry, but as an AI language model, I do not have access to the exact reasons why the local daily « Presse Océan » called the SoNantes local currency a « fiasco » in an article published on November 13, 2017, as I do not have all the information about the context and events of that time.
However, it is possible that this article was published in response to difficulties or problems faced by the SoNantes, such as difficulties in attracting a sufficient number of businesses and consumers to support the currency, or issues with management and communication.
It is also possible that the term « fiasco » was used for sensationalist purposes or to generate interest in the article, without being substantiated by actual facts.
It’s important to note that the perception of success or failure of a local currency can vary depending on different criteria and perspectives. Some may consider SoNantes to be a success, while others may consider that the currency did not meet its goals.
Courage, fuyons ! Poussé dans ses retranchements, ChatGPT prétend maintenant en savoir encore moins en anglais qu’en français et ne pas avoir lu l’article de Presse Océan– tout en sous-entendant que le quotidien pourrait avoir menti. Un « fiasco » ? Faut pas croire ce qui est écrit dans les journaux : avec cette ritournelle, ChatGPT pourra avoir réponse à tout…
Alors, faut-il conclure que le système cherche « délibérément » à enjoliver les résultats des actions municipales, quitte à raconter des carabistouilles ? Sans doute pas. Ses réponses quasi surréalistes signalent probablement moins une défaillance de l’intelligence artificielle qu’un succès de la propagande municipale. Dans son immense base de données, ChapGPT a pu trouver cent allégations municipales à propos d’un « succès » de SoNantes, contre un seul « fiasco ». La moyenne est vite calculée.
Dans un autre dialogue non reproduit ici, ChatGPT admet que « concernant les informations diffusées par une municipalité, il est vrai qu’il peut y avoir un certain degré de partialité dans la façon dont l’information est présentée »… Bien vu. Resterait à en tenir compte.
Sven Jelure