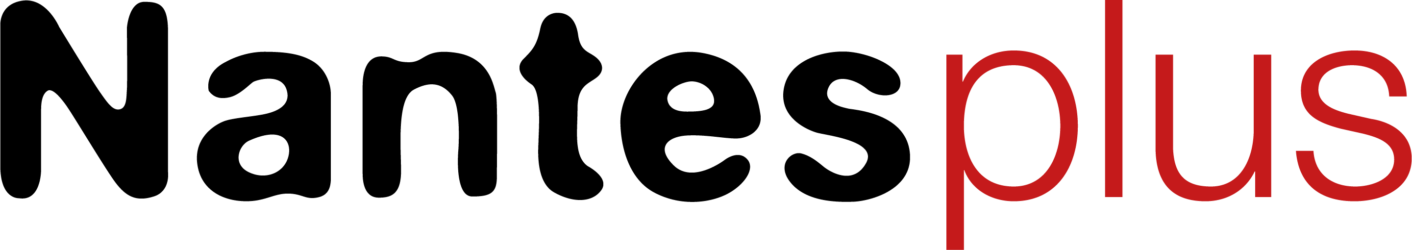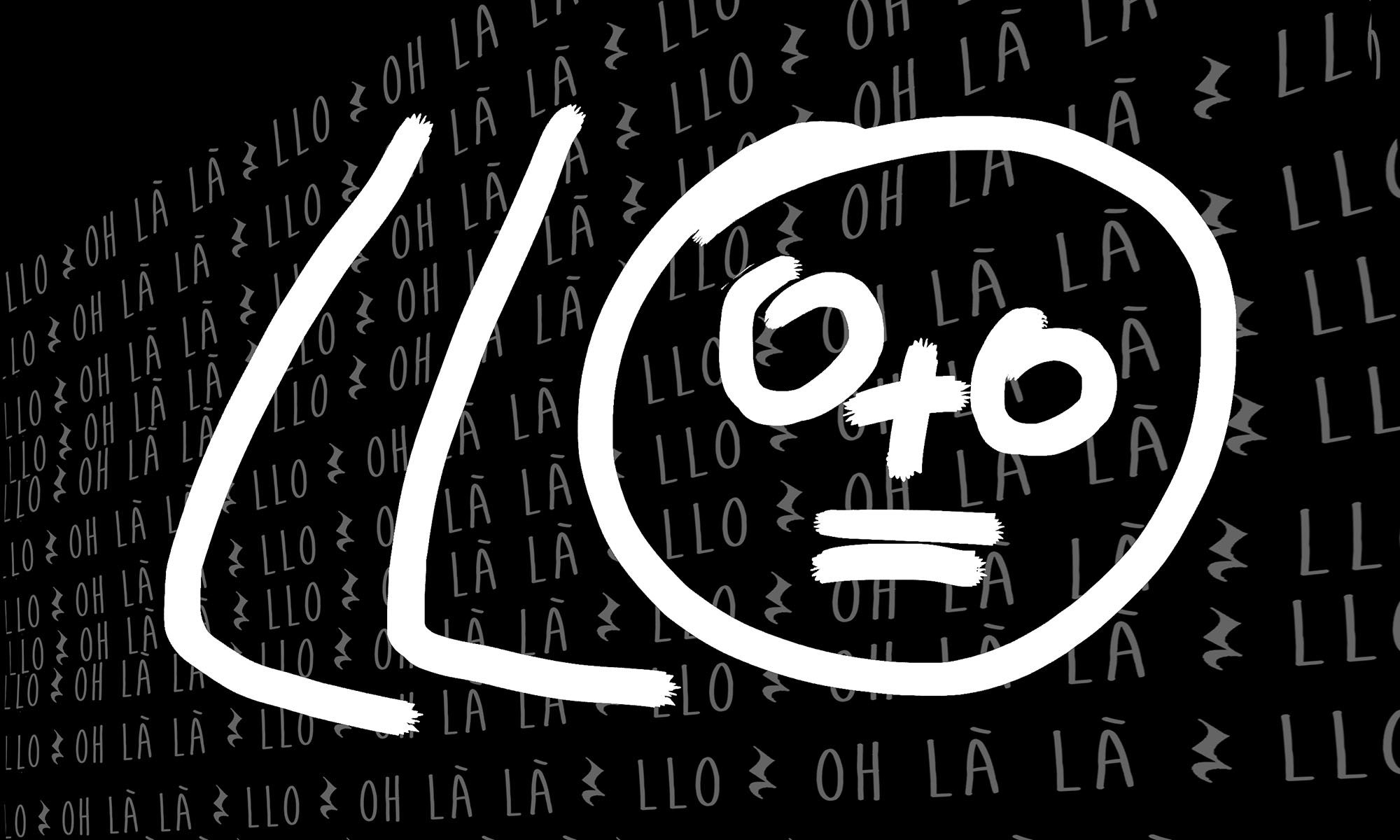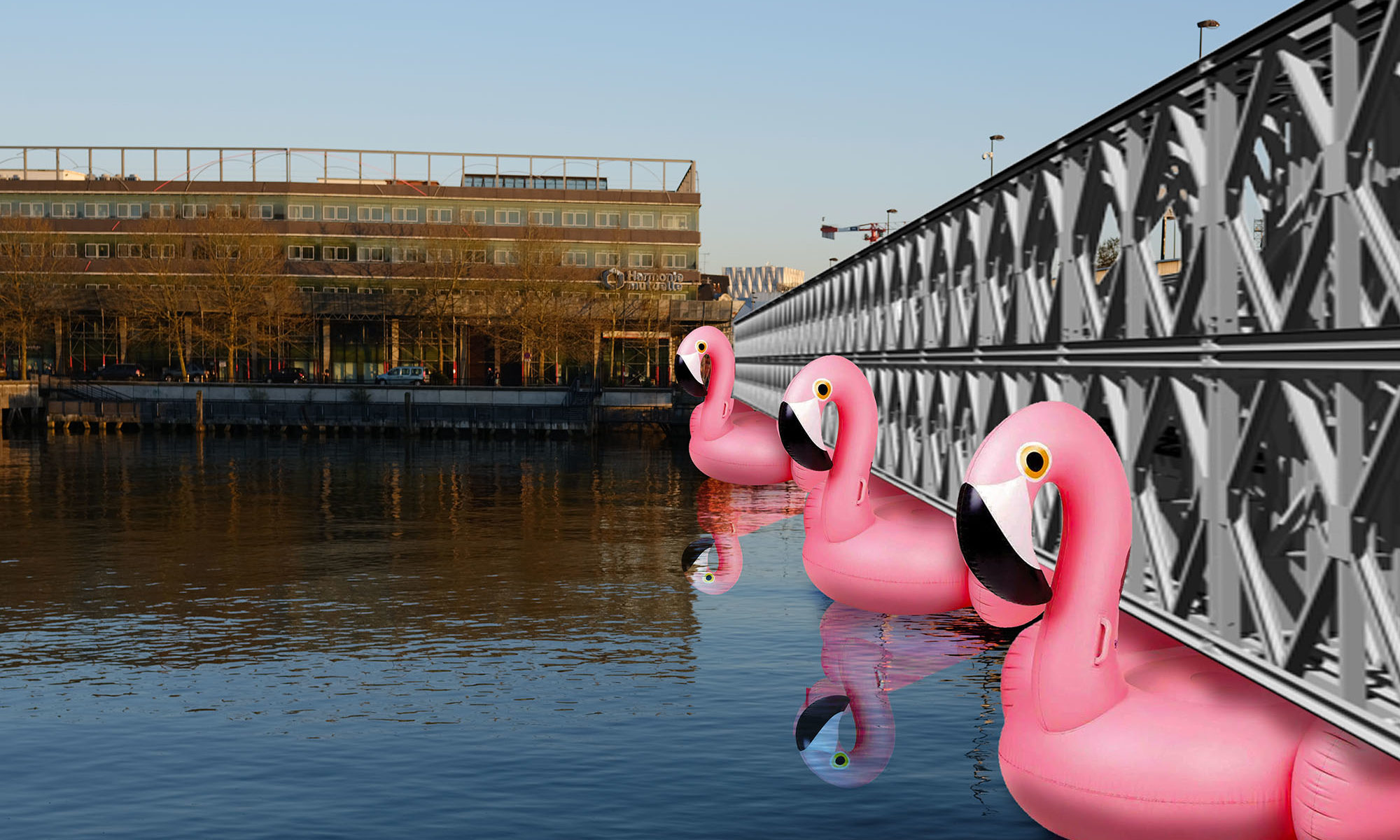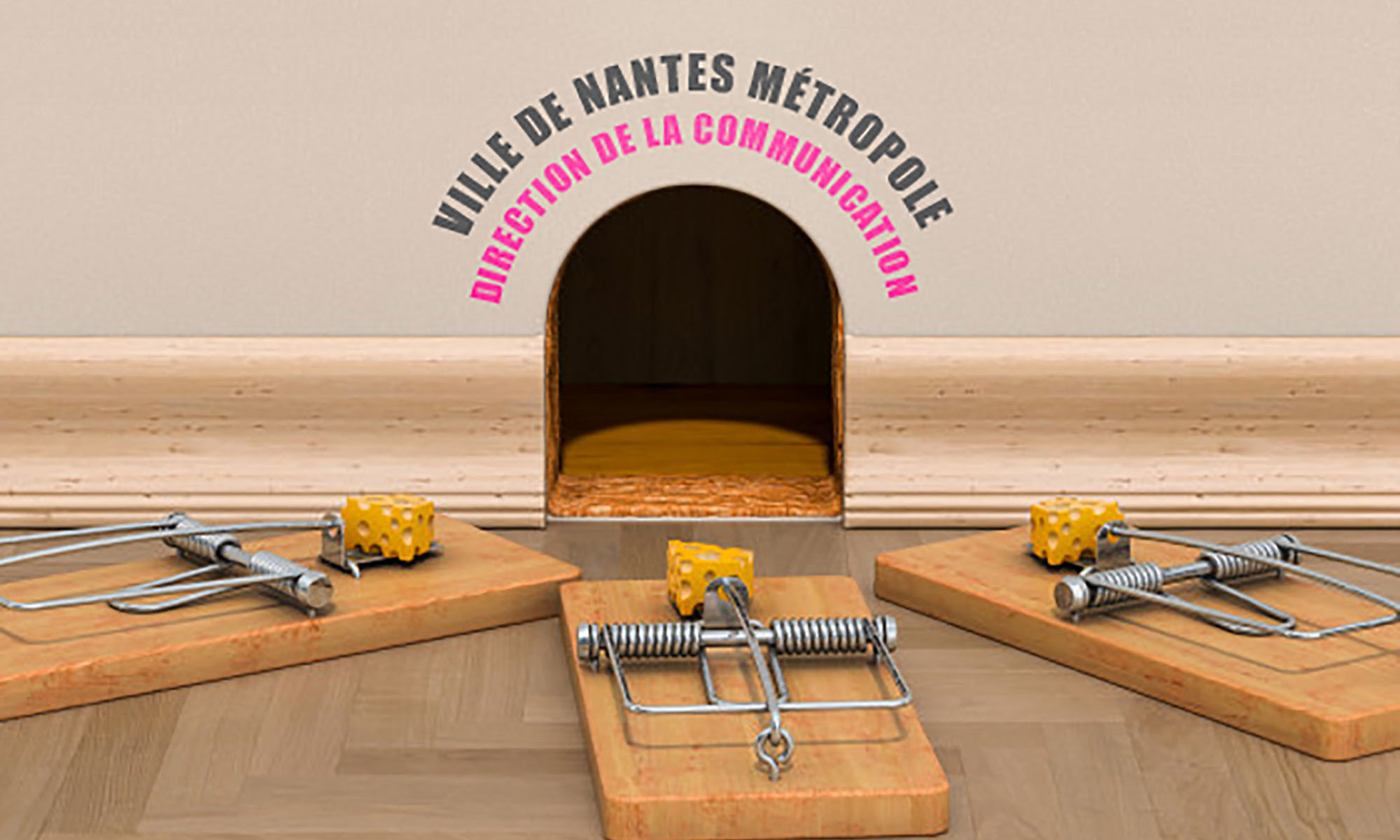Sauf erreur, personne n’a encore parlé de « fiasco judiciaire » dans le dossier de la disparition de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique 2019. Pourtant, l’instruction s’avère déjà beaucoup plus longue que productive.
Dès le premier jour, l’affaire est des plus délicates. Rassembler des milliers de fêtards en pleine nuit sur un quai de Loire est une grosse prise de risque, intervention policière ou pas. En cas de pépin, la jurisprudence ne donne pas cher de Johanna Rolland. Exemple : une commune organise un feu d’artifice, une zone interdite est délimitée par un ruban, une personne le franchit, elle est blessé par une fusée qui retombe, le maire est condamné à six mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende car un ruban n’est pas une protection suffisante. (En l’occurrence, la limite était fixée à 150 m de la zone de tir, soit trois fois la largeur du quai Wilson, mais ne comparons pas ce qui n’est pas comparable, puisqu’à Nantes il n’y avait même pas de ruban.)
La maire de Nantes est mieux protégée que le quai. Dès la disparition de Steve signalée, bien avant que son sort ne soit connu et avant la moindre enquête, un narratif simple s’installe : Steve a été jeté à l’eau par une charge de police. Là, pas question sur l’organisation de la fête ou les pouvoirs de police du maire. Ce récit est propagé par une convergence, délibérée ou pas, entre des militants locaux, des membres de la presse locale (voire nationale puisque l’un d’eux est aussi correspondant du Monde à Nantes) et l’avocate de la famille de Steve Maia Caniço.
Charger le commissaire pour dédouaner la maire
Cette avocate déploie beaucoup d’énergie pour que l’enquête vise uniquement le commissaire de police qui a mené une intervention sur le quai Wilson. Selon Le Monde, elle « redoutait de voir délayées les responsabilités dans cette affaire ». En attaque, on clarifie, en défense, on obscurcit, dit un dicton en usage chez les avocats. Un seul suspect, c’est plus clair ! Mais dans une affaire où il y a mort d’homme, faire passer la tactique avant la recherche de la vérité est tout de même très moyen.
Et probablement très maladroit. Dans l’affaire du feu d’artifice évoquée plus haut, la commune a été condamnée à indemniser la blessée. En misant tout sur la responsabilité d’un policier, il n’est pas dit que l’avocate agisse dans l’intérêt de ses clients. En revanche, elle contribue à protéger Johanna Rolland, dont elle est très, très proche. Contre Attaque, qui détaille les liens entre elles, se montre sévère :
Bien sûr, ce n’est pas Johanna Rolland qui a poussé le jeune danseur dans la Loire, mais sa responsabilité dans la cascade d’événements qui ont abouti au drame ne fait aucun doute. Depuis le début, la mairie fait tout pour canaliser la colère légitime provoquée par la chute dans la Loire de jeunes nantais-es un soir de fête. Les camarades socialistes de l’avocate portent une responsabilité dans la mort de ce jeune homme qui ne souhaitait que danser pour la fête de la musique.
Instruction cabossée
Pour les « camarades socialistes », malgré tout, les perspectives paraissent moroses quand, fin 2022, l’instruction s’achève. Le procureur de la République résume : il y a eu « deux types de fautes », les unes au stade des préparatifs de la fête, les autres au stade de l’intervention policière, qui ont « contribué de manière certaine » au décès de Steve. La thèse du coupable unique est rejetée.
Volens nolens, les juges d’instruction ont remonté toute la chaîne causale. Une dizaine de personnes sont mises en cause pour homicide involontaire. Le préfet de Loire-Atlantique de l’époque, son directeur de cabinet et le commissaire de police sont mis en examen. La maire de Nantes, son adjoint à la sécurité et l’opérateur de sound system qui a déclenché la bagarre sont placés sous statut de témoin assisté.
L’instruction n’est pourtant pas sans reproche. En octobre 2022, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes a infligé un double camouflet au juge. Elle a annulé la mise en examen de l’ancien préfet de Loire-Atlantique (qui reste tout de même placé sous statut de témoin assisté). Surtout, elle a prononcé la nullité d’une expertise vidéo commandée par le magistrat à une association ouvertement militante, spécialisée dans la lutte contre les violences policières. Un doute plane sur la neutralité de l’instruction.
Un très long délai de réflexion
Mais ce n’est rien à côté de la surprise du chef qui intervient fin 2023 : soudain, tout le monde descend, ou presque ! Ordonnance de non-lieu général, sauf pour le commissaire de police. La « cascade d’événements » s’est tarie. Après une année supplémentaire de réflexion, faisant suite déjà à plus de trois ans d’instruction, les juges considèrent que les fautes commises au stade des préparatifs de la fête ne sont pas « caractérisées ». Les protagonistes n’étaient sans doute pas conscients des dangers du quai Wilson.
À six jours de Noël – sûrement un hasard du calendrier ‑ ce coup de théâtre ne fait guère de vagues. Les Nantais sont absorbés dans la contemplation des œuvres du Voyage en Hiver. Libération s’étonne tout de même : en novembre 2022, le ministère public considérait que le directeur de cabinet du préfet avait « pleinement conscience du risque de chute en Loire », puisqu’il avait même été décidé de faire appel aux sauveteurs de la Sécurité Nautique Atlantique ! Et puis finalement non…
Est-ce un changement d’avis ou plutôt un aveu de faiblesse ? Au « cœur de l’enquête », selon l’expression du Monde en juin 2020, se trouve le téléphone de Steve Maia Caniço : « L’objectif, c’est d’obtenir une géolocalisation précise de Steve au moment du drame ». Ce moment, suppose-t-on, est immédiatement postérieur au dernier signal émis par le téléphone, à 4 h 33 secondes. Un premier nuage de gaz lacrymogène vient alors de balayer sur une centaine de mètres le quai Wilson (qui mesure environ 1 km de la grue Titan grise au pont des Trois-continents). Steve se trouve-t-il à cet endroit ? Sans une géolocalisation précise, le « cœur de l’enquête » est opaque.
Manque de discernement et de renseignements
Dans ces conditions, il est probable qu’une dizaine d’avocats, y compris ceux de la maire et du préfet, auraient défilé pour dire : « On ne sait pas où Steve est tombé à l’eau. On ne sait pas comment. Il a pu être poussé, il a pu glisser, il a pu être attiré par le chant des Sirènes [Il n’y a pas de Sirènes dans la Loire ? Qu’en savez-vous, surtout après 4 heures du matin ?]. Quant à reconstituer à l’envers un parcours depuis la grue jaune, lieu de la découverte du corps, jusqu’à un point de chute précis dans un autre bras de Loire cinq semaines plus tôt, c’est mission impossible. » Le non-lieu presque général coupe court à cette litanie improductive.
Bien entendu, l’avocat du commissaire Chassaing pourra en dire autant. Mais il sera seul et craint que son client ne serve de bouc émissaire dans une affaire plus riche en émotions qu’en éléments objectifs. Il se référera sans doute au rapport établi par l’Inspection générale de l’administration (IGA), qui contient les principaux éléments connus. Pour mémoire, ses conclusions sont triples :
« 1. L’organisation administrative de la Fête de la musique a mobilisé […] les services de la ville et ceux de la préfecture de Loire-Atlantique, sans accorder une attention suffisante à la présence des sound systems sur le quai Wilson. «
« 2. La ville de Nantes et la préfecture de la Loire-Atlantique […] disposaient de moyens réglementaires pour davantage prendre en compte la sécurité de l’événement. »
« 3. […] la gestion des dispositifs de sécurité et de secours conduit à s’interroger sur la pertinence de certains choix opérés quai Wilson et à constater un manque de discernement dans la conduite de l’intervention de police. »
Dans ce « manque de discernement » maintes fois évoqué, certains voient la condamnation du commissaire. Or l’expression a manifestement été choisie pour éviter le mot « faute ». Et elle s’applique apparemment à la première partie de l’intervention policière, l’approche des lieux sans précautions particulières. Quant à l’emploi des gaz lacrymogènes, l’IGA le qualifie expressément de « légitime défense » car il fait suite à des incidents au cours desquels cinq policiers ont été blessés. Autrement dit, même une géolocalisation précise sur le quai Wilson ne préjugerait en rien de la suite que le désir primal de vengeance l’emporterait sur la présomption d’innocence.
Communication catastrophique
À ce stade, l’avocate sait forcément que son dossier est mal embarqué : elle a misé sur un narratif très difficilement démontrable. Quelles possibilités lui reste-t-il ? Présenter l’accusé sous le plus mauvais jour possible. Presse Océan lui a consacré deux pleines pages le 16 janvier ‑ une besogne confiée à un journaliste indépendant et non à un membre de sa rédaction. Grégoire Chassaing y est décrit comme « trop impulsif », « diversement apprécié », « un peu psychorigide », « parfois obtus », etc., aimables appréciations recueillies auprès de syndicalistes policiers qui ne sont pas de ses amis.
Or voici que le commissaire est promu ! Il prendra un nouveau poste le 1er juin, deux semaines avant le début de son procès. Évolution de carrière statutaire pour un fonctionnaire qui bénéficie de la présomption d’innocence, assure le ministère de l’Intérieur. « Provocation vis-à-vis de la justice », répond la mère de Steve (Presse Océan, 10 février 2024), qui s’exprime pour la première fois, dans les bureaux de son avocate. La douleur d’une mère qui a perdu son enfant est forcément poignante. Et voilà que sa propre avocate l’instrumentalise en vue de transformer un deuil privé en conflit police/justice ! Cette dernière cartouche parachève le fiasco.
Sven Jelure